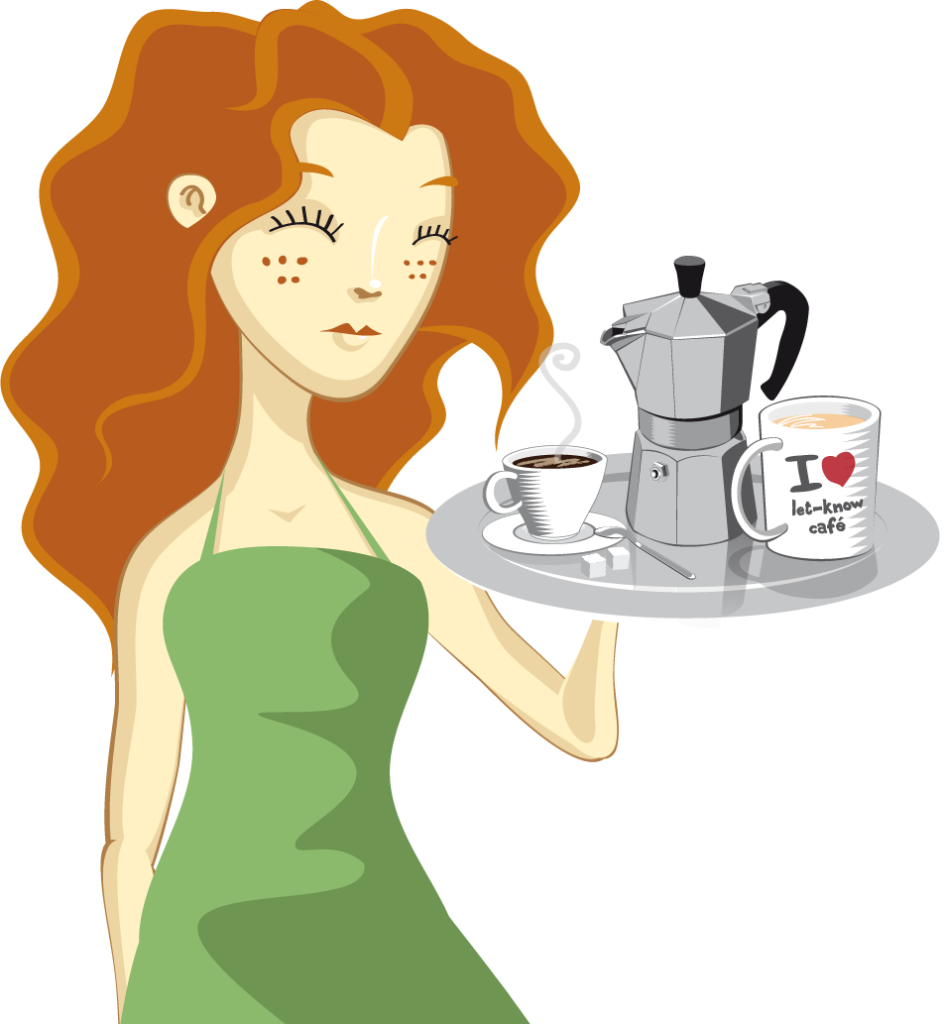La leçon de vie d’un bon vieux feu rouge (audio)
Jean Faya
15 août 2016
C’est l’été, un lundi soir dans le centre-ville de Lyon, au tout début du mois d’août 2015. Il fait divinement chaud. Le soleil décline et a passé la journée à transformer le béton des rues en douce pierrade. Lucas M. profite de son trajet en voiture vers un magasin de bricolage en périphérie de la ville. Il est seul. Il écoute la musique que lui propose une fréquence FM sélectionnée au hasard. C’est agréable de conduire fenêtre ouverte et de sentir le vent de la vitesse, soulager de l’air brûlant. Il arrive au bout du quai Augagneur devant la fosse aux ours. Il aperçoit le prochain feu tricolore, au vert, qui se rapproche et semble l’attendre. Lucas distingue à son niveau, les trottoirs de chaque côté, prêts à vivre le départ de leurs amas de piétons qui s’impatientent. Le feu, un grand et vieux feu bien droit, d’un gris élégant et à la bonhomie du patriarche, fait signe à Lucas en changeant de couleur. Passant au rouge, il l’invite à s’arrêter. Lucas stoppe sa voiture en première ligne devant le passage pour piétons. Et les deux amas de personnes prennent impulsion pour se jeter l’un vers l’autre. En contemplant ce mouvement, Lucas est intrigué par deux jeunes femmes armées de raclettes lave-vitre. Il lui semble que ce sont des Roumaines. Et il comprend bien vite qu’elles se dirigent vers son pare-brise, et que le grand tricolore convoque là une rencontre. « Je vais y avoir droit » se dit-il tout bas, un brin amusé. Lucas a souvent eu l’occasion dans son travail de médecin de rencontrer des Roms Roumains. Dans le cadre d’engagements associatifs, il est allé maintes fois dans le passé, sur des terrains vagues où les personnes trouvaient endroit pour se poser. Il a suivi bon nombre de patients, vécu bon nombre de situations des plus improbables et parfois incroyablement rocambolesques. Il se souvient de la course poursuite au volant sa voiture chargée d’une famille en deuil, dans Pierre-Bénite, avec le corbillard emmenant la dépouille du défunt quand le personnel de la morgue de l’hôpital n’avait pas attendu ses proches pour la mise en bière car il était écrit « indigent » sur le cercueil. Il se souvient, alors qu’il visitait des familles sur un bidonville, de cette femme qui attaquait à pleines dents gâtées, un saucisson entier, assise avec sa copine, en le reluquant d’un œil aguicheur, la scène aux portes de la pornographie, ponctuée d’éclats de rires moqueurs. Il se souvient du vieux avec ses grandes moustaches et sa jambe qui pourrissait, et que le chirurgien avait fini par couper. Il se souvient de tous ces visages burinés, ridés par le froid ou bouffis par le chaud, de ces rires, de ces colères, de cette odeur de fumée, de ces demandes infinies de sachets contre la diarrhée, de logements, de papiers, de nourritures, de poubelles, d’eau potable. Mais là, seul Lucas sait qu’il est médecin. Et il n’est pas sur un lieu de vie pourri mais à un carrefour surchauffé par l’été, planté là par un feu rouge avec deux femmes roumaines armées de raclettes, face à une cinquantaine de personnes sur le point de s’entrecroiser, juste sous son nez.
Il est bientôt au contact de la plus âgée des deux jeunes femmes. Machinalement, il cherche une pièce dans la poche de son pantalon, juste au cas où, sans savoir s’il la donnera. La femme arrive au niveau de la fenêtre ouverte de la voiture. Elle désigne sa raclette et dit : « Roumanie, pas de maison. Pour manger s’il vous plait… » L’accent est marqué et lugubre. Le temps semble s’arrêter… Les piétons passent devant le pare-choc de la voiture, et commence l’entrecroisement, pour l’instant sans aucune percussion. Lucas M. a l’impression paranoïaque que tous regardent la scène de sa rencontre, amusés et guettant sa réaction. Du coup, dans une sorte de pudeur, il tente de s’extraire. Il fait un non de la main et de la tête, mimant le genre de geste qu’il a souvent vu d’automobilistes agacés. Mais il sent qu’il manque de détermination, et il laisse échapper un demi-sourire. La jeune femme semble de son côté, se retrouver d’une façon également imprévue, dans un entre-deux similaire. Surprise de ce non souriant, sorte de non qui dit oui, elle esquisse à son tour un demi-sourire et les deux restent là, l’un face à l’autre, sans trop savoir quelle suite donner à ce moment. Lucas finit par lui dire en libérant cette fois un franc sourire : « Pas facile en France… » Et là, le visage de la jeune femme s’ouvre à son tour entièrement. Elle lui sourit d’un regard clair et lumineux. Elle pose son seau et sa raclette. Lucas est surpris de ce contact-là et de ce qu’il voit. Le visage de son interlocutrice est fin. Il dégage un pétillement sympathique. Elle est, de fait, fort jolie. Elle lui répond, philosophe et joyeuse : « Oh, non… on se débrouille… ça va… » Elle parle un français presque parfait, avec un léger accent. Un peu désarçonné, Lucas lui demande :
– « Vous arrivez à vous loger ?
– Oui, je vis dans une maison, enfin, une baraque de planche, là-bas, près du périph.
– Vous parlez très bien français, vous avez pu aller à l’école ?
– Oui, un peu, mais maintenant j’ai un bébé, alors je ne peux plus… »
« Un bébé ? » lance-t-il en riant. « Mais vous avez quel âge ? » Elle rit aussi en lui disant qu’elle a 19 ans, dans une grimace espiègle.
Le grand tricolore passe au vert de façon assez incompréhensible. Pourquoi avoir convoqué une si singulière rencontre pour l’interrompre, maintenant que connaissance est faite. Lucas se trouve assez malheureux. Ses idées s’emmêlent. Il sent la pièce dans sa main. Il hésite. Puis il la lui tend : « tenez, je ne sais pas si cela vous aidera… » Elle la prend et le regarde, parée toujours de son joli sourire, et hausse les épaules, l’air de lui dire qu’elle s’en fiche en fait de la pièce. Ils se disent au revoir. Et Lucas démarre… Le feu le regarde s’éloigner, l’air entendu et satisfait. Quelle curieuse rencontre, se répète Lucas. Si différente des autres. Et il reprend sa route, heureux et plein de pensées, vers le magasin de bricolage.
Un jour, quelques semaines plus tard, Lucas rentre chez lui à pied. Il entre dans le parc de la Tête d’Or par la porte principale. Il pense à ce moment que lui a fait vivre le bon vieux feu rouge de la fosse aux ours. Il a le sentiment que ce grand tricolore a voulu lui donner une leçon. Il cherche à comprendre. Il se dit que cette rencontre-là avait quelque chose de complet quand les autres dans des souvenirs plus anciens, lui semblent du coup bien partielles. Il se dit qu’il a abordé cette personne ni dans l’attitude de l’aidant médico-social, ni dans l’attitude qu’il a tenté d’adopter au premier moment, celle du français énervé par les mendiants à la raclette lave-vitre. Ni victime, ni coupable dans ce moment-là ? Une rencontre débarrassée de ses filtres sociaux, où le contexte imprévu avait offert une sorte d’accès direct à l’autre ? Juste un espace qui par le hasard de la conjoncture, s’était vidé brutalement ? Et ce vide-là a-t-il offert de façon tout à fait inattendue et gratuite, un endroit à la rencontre où se loger et se dérouler à loisir, sans obstacle ni frottement ? Lucas se dit que cet instant de vérité a été sûrement possible du fait d’une curiosité réciproque, d’une capacité dans ce court instant de l’un et l’autre à aller vers l’autre et l’un.
Tout en marchant, il feuillette comme à son habitude des écrits. Ce jour-là, c’est l’Homme, revue française d’anthropologie. Il aime à la parcourir quand il trouve un peu de temps. Il croise alors un article intitulé « de la vie en société à la vie en culture ». François Flahaut[1], l’auteur, construit justement son article autour de la notion d’« attention conjointe », qu’il présente comme une aptitude à s’engager à plusieurs dans un processus commun. Incroyable, se dit Lucas. Les yeux écarquillés, il se concentre autant qu’il le peut sur chaque mot des lignes, dans l’intuition qu’il va là trouver la clé de la leçon du feu rouge. Il lit : « L’attention conjointe, en somme, est cette structure relationnelle triangulaire qui tend à transmuer les choses et les activités en éléments culturels. » Triangulaire quand ils n’étaient que deux ? Quelle activité ont partagé Lucas et la femme roumaine ? Bien peu de choses, rien de plus qu’une discussion, des paroles. Mais oui, leur rencontre s’est bien déroulée à travers le langage, dans le dire. Lucas pense à l’expression de Michel Foucault[2], « aller à travers le langage, jusque vers le lieu où les choses et les mots se nouent ». Oui, c’est peut-être ça le troisième point du triangle, qui permet ce qui a intrigué Lucas en premier lieu : il se souvient avoir entendu parler la jeune femme d’une première phrase au fort accent, puis celui-ci s’est complétement effacé par la suite. Est-ce elle qui a changé sa manière de parler en revoyant ses objectifs, ou lui qui a créé ce qu’il entendait ? Son cerveau aurait-il pu lui jouer des tours, et ses représentations mentales générer les musicalités linguistiques ? Autrement dit, la façon dont il percevait cette femme aurait-elle pu créer la façon dont il l’entendait parler ? Il est vrai, comme il le lit dans l’article, que les activités sont médiatisées par des pratiques relationnelles intériorisées par les partenaires. À force d’avoir entendu cette façon de s’exprimer dans la plainte, Lucas pouvait-il entendre cette personne qu’il pensait au départ dans ce même registre, avec un autre accent ?
Il lève la tête de son livre, reprend contact avec le parc qu’il traverse, laisse reposer son regard vers le haut et la profondeur des feuillages d’arbres immenses. Il voit le soleil scintiller tout derrière, quand celui-là arrive à laisser passer quelques de ses rayons entre les feuilles. Ainsi aéré, il médite : nous passons notre temps à mettre du sens sur la réalité. Nous passons notre temps à organiser intellectuellement le monde qui nous entoure, les êtres, les choses, les événements, pour qu’ils nous conviennent au mieux. C’est ça, l’efficience des cultures humaines au service de l’adaptation à notre environnement. Il se rappelle des travaux de Franz Boas[3] sur la perception des sons et des couleurs de la neige notamment, chez les Eskimos de la Terre de Baffin. Boas a mis en évidence que la perception des habitants est tout à fait distincte de la sienne, alors qu’a priori la neige est la même pour tous et que, par conséquent, il ne devrait pas y avoir de variations. Il en déduit la relativité des conceptions du monde environnant, ce que l’on admet assez bien, mais aussi la relativité des perceptions de la réalité, ce qui n’est finalement pas si simple à recevoir. Lui, infère cela aux contraintes de la langue. C’est là se dit Lucas, l’intérêt de ce récit : savoir regarder l’eau de son bain culturel, se représenter la place ou le rôle que l’on occupe de ce fait par rapport à l’autre. Changez l’eau de votre bain et vous entendrez la personne d’un accent différent. Changez de rôle et le rôle de l’autre aura une tout autre couleur.
Si le langage est le troisième pied de la relation qui s’est vécue dans l’attention conjointe entre Lucas et la femme roumaine, il est aussi une autre chose, un autre troisième point de triangulation qui s’est vu à son tour transmué en élément culturel. Oui, dans cette aptitude que ces deux-là ont eu à s’engager dans un processus commun, on se plairait bien à voir naître une authentique coopération, voire même une sorte de nouvel altruisme. Mais mince, rien n’est parfait : Lucas regrette de ne pas avoir osé garer sa voiture et inviter cette femme, avec son acolyte, à s’asseoir tous trois à la terrasse d’un café et échanger sur les mondes de chacun. Mais il regrette bien davantage d’avoir conclu la rencontre en lui donnant sa pièce de monnaie. Et cette pièce doit là prendre de l’intérêt et même de l’existence dans notre histoire, par le rôle de médiation décisif qu’elle joue dans la relation entre les deux. La triangulation qu’instaure l’attention conjointe, insère cette pièce qui met à jour le paysage mental et culturel de Lucas. Lucas la serre dans sa main tout le long. Puis il hésite et fait le choix de la donner. Alors dans cette expérience où Lucas se sent en lien avec son interlocutrice, la pièce va tristement en quelque sorte le « resocialiser », le remettre dans ses schémas familiers aidant-aidé, et si l’on peut dire, le « reculturaliser ». Et la jeune femme ne va pas s’y tromper, haussant les épaules, sûrement un peu déçue. Chasse le culturel et il revient au galop !
Bon, mais allez, ce n’est pas grave, Lucas est un homme comme les autres, la belle affaire ! Il n’en reste pas moins qu’en s’engageant ensemble à converser, la Roumaine et lui ont passé un bon moment, et ça, reculturalisé ou pas, ce n’est pas rien ! Toujours le nez dans sa revue, Lucas M. sort du Parc de la Tête d’Or par la porte juste avant la voie ferrée. Dans l’article de l’Homme, François Flahaut, aborde le travail de Michel Kreutzer, un éthologue qui a beaucoup observé les canaris. Même si leur chant a bien sûr pour ces oiseaux une valeur adaptative (défendre leur territoire, se signaler à l’attention des femelles), le scientifique rapporte, que chez le canari qui chante, les circuits dopaminergiques (également appelés « circuits de récompense ») sont activés, surtout lorsqu’il chante en présence d’un ou plusieurs congénères. Autrement dit, cela fait plaisir aux oiseaux de se livrer aux activités auxquelles ils s’adonnent spontanément, en l’occurrence chanter. Et les oiseaux ont un cerveau suffisamment complexe pour qu’ils éprouvent un plaisir à sentir qu’ils vivent. Oui se dit Lucas, elle doit être là, la leçon de vie du feu rouge : lui montrer que les rencontres ont bien sûr un intérêt « adaptatif », celui de gagner sa vie, autant que de lui donner du sens, mais elles ont un intérêt en elles-mêmes, en soi. Les rencontres sont des occasions de stimuler la sensation de vivre, des occasions de se manifester en lien avec les autres, des occasions de s’éprouver vivant dans l’expérience interactive d’être affectée par un sourire et d’y réagir. Et comme le dit Flahaut dans sa conclusion, il y a là une source de bien-être ou de plaisir qui doit être recherchée juste pour elle-même.
Et ce jour-là comme les canaris, Lucas et la jeune femme roumaine, ont mis à profit leur cerveau suffisamment complexe, pour que, grâce à quelques mots imprévus, ils poétisent leur existence. Sous le bon vieux feu rouge, ils se sont offert l’expérience de se vivre en chimère, par-delà ou grâce à leur culture, juste pour le seul plaisir de se sentir vivant.
[1] FLAHAUTL François (2015). De la vie en société à la vie dans la culture. Le rôle de l’attention conjointe et l’émergence de réalités autoréférentielles. L’Homme. Revue d’anthropologie. Avril/juin 2015. n°214. p. 110
[2] FOUCAULT Michel (1983). Les mots et les choses. Paris : Gallimard.
[3] BOAS Franz (1889). The alternating Sounds. American Anthropologist, vol II, n°1, p. 47-54