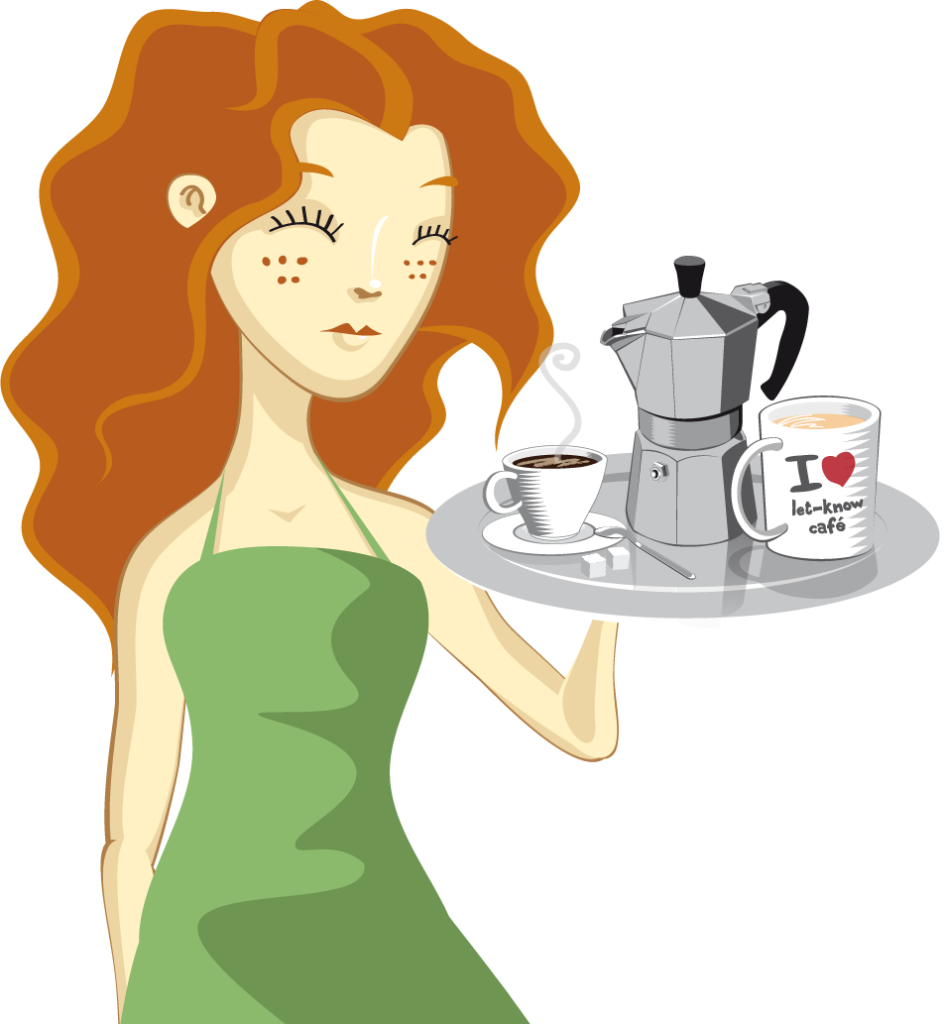Coup de cœur : Les raisons du corps
Atlantide MERLAT
2015
Atlantide MERLAT alors, intervenante sociale en Maison Relais, aujourd’hui, responsable de la coordination des interventions sociales ARALIS, et étudiante en Master 2 de sociologie, ANACIS à l’université Lumière Lyon 2
2015
« Sans la maison, l’homme serait un être dispersé. Elle maintient l’homme à travers les orages du ciel et les orages de la vie. Elle est corps et âme »
Gaston Bachelard, La poétique de l’espace
Les personnes en errance ont un rapport à l’habitat assez indissociable du rapport au corps. J’ai commencé ma carrière de travailleur social dans un accueil de jour pour SDF où s’entassaient quotidiennement quatre-vingt-dix hommes isolés dans une péniche. Très vite j’ai dû réévaluer les normes de distances sociales que j’avais intériorisées et accepter que des inconnus me parlent de très près, me postillonnent dessus, me touchent les mains. C’est comme ça qu’ils ont cessé petit à petit d’être des inconnus. J’ai vu les gens vomir, cracher, pisser juste à côté de moi des dizaines de fois. Je crois qu’il ne s’agissait pas d’un problème d’hygiène en tant que tel mais de quelque chose de l’intime qui vient se déverser dans la sphère sociale. Quand la parole est rudimentaire et que la vie interne se fait discrète, le corps occupe l’espace dans la relation et donne à voir l’expression physique d’une souffrance psychique.
Assez vite j’ai été amenée à travailler dans des institutions proposant des modalités d’habitat plus ou moins précaires ayant une double fonction de mise à l’abri des corps et d’accompagnement social des personnes à partir de leur lieu de vie. La commande institutionnelle relève d’un accompagnement autour de ce que l’on appelle « le savoir habiter » qui parle directement de la capacité à investir un chez soi et à user correctement des lieux. Habiter suppose des modalités d’investissement psychique nécessairement complexes pour des personnes en mal d’habiter leur propre corps. Comment faire chez soi avec toute la difficulté du monde à vivre en-soi. Cette perturbation de l’appropriation d’un soi et d’un espace fait écho à la difficulté d’être en lien. L’angoisse, l’incapacité d’être seul, l’incapacité d’être avec l’autre, ponctuent le quotidien des usagers. Demeurer durablement dans un foyer n’écarte pas forcément la problématique de l’errance qui reste inscrite sur le plan psychique.
À partir de là, habiter ne peut se résumer à l’usage normatif d’un logement ordinaire. L’appropriation d’un chez soi n’a pas grand-chose à voir avec le degré de confort des lieux. J’ai constaté dans des opérations de réhabilitation des vieux foyers toute la difficulté à convaincre des résidents logeant dans 7m² de déménager pour un studio neuf. Avant le confort, le chez soi est fait d’imaginaire et de narration. Personne ne penserait s’asseoir sur le canapé d’un SDF même si ce canapé est sur la place publique. Nous voyons tous, qu’il a bâti autour les murs de sa demeure. Pour essayer d’aider, nous composons avec des situations éloignées des normes sociales. En matière d’hygiène, le problème est de savoir à quelles normes on se réfère. Nous avons tous un rapport singulier à l’hygiène et nous naviguons avec dans une interprétation de ce qui est attendu socialement. Le logement des personnes que j’ai accompagnées est souvent à l’image de leur fonctionnement psychique: globalement trop ou pas assez. Trop sale, trop propre, trop investi, pas occupé, trop ouvert sur l’extérieur ou trop impénétrable. La maison s’apparente un peu à une seconde peau contenante qui rassemble des individus éparpillés. Une coquille toujours trop pleine ou trop vide mais dans laquelle il est possible de se recroqueviller. Et tant bien que mal, ceux qui erraient hier habitent aujourd’hui.
Pour accompagner au savoir habiter, on ne peut pas agir en sommant le résidant d’user des lieux correctement. Il ne suffit pas de demander à quelqu’un de décorer son appartement ou de vider les poubelles pour qu’il le fasse. Techniquement il sait faire. Mais il ne peut pas. On est alors confronté à l’impuissance d’agir sur le symptôme. Je crois qu’accompagner à l’appropriation d’un chez soi passe plutôt par l’accompagnement vers l’ancrage et l’attachement.
Christine est une toute petite dame retraitée, amaigrie, à la dentition abîmée. Sa coiffure et ses vêtements traduisent une négligence évidente pour son apparence. Elle est assez laide et dispose d’un fort capital sympathie. Elle a quelque chose d’une petite fille, notamment dans la manière de s’exprimer et d’évoquer le souvenir de sa mère décédée. Été comme hiver elle porte le même bermuda et les mêmes sabots de profession médicale. Elle semble n’avoir jamais froid. Christine a vécu une expulsion locative violente et a été immédiatement prise en charge à l’armée du salut où elle est restée sept ans pour se reconstruire. Elle n’avait jamais connu les foyers avant. Elle a ensuite été accueillie dans la pension de famille où je travaille. C’est un établissement de 19 petits logements personnels articulés autour d’espaces de vie collective. Christine occupe un studio qu’elle paye rubis sur l’ongle et il faut souligner qu’elle a une situation financière confortable. Elle a travaillé de nombreuses années et pris grand soin de faire des économies. À l’exception de quelques poupées, son logement est vide. Aucun meuble personnel, aucune décoration, pas de télé, pas de radio, pas de vaisselle. Elle mange froid et boit froid (même le café) depuis des années. Elle dit elle-même qu’elle préfère pique-niquer. Pourtant elle habite bien là, dans ce logement vide qu’elle désigne comme chez elle depuis cinq ans maintenant. Elle ne sort que très rarement de son appartement à l’exception du soir pour faire quelques courses alimentaires et à l’occasion de repas collectifs. Retranchée chez elle, il est nécessaire de converser à travers la porte pendant très longtemps avant qu’elle ne se décide à descendre. Il lui arrive parfois d’être prise de crises d’angoisse impressionnantes pendant lesquelles elle se met à hurler dans son logement. Elle exprime sa terreur de « crever seule ici ». Pour tenter de maîtriser ses angoisses, elle lave son appartement et son corps à grands seaux d’eau de javel. Ses tocs de propreté sont, dit-elle, issus d’une peur des microbes qu’elle traîne depuis l’enfance. Elle a fini par saccager tout le mobilier de son logement ce qui lui a valu de la part de l’équipe précédente un certain nombre d’avertissements. Avec le temps, j’ai constaté que ses tocs parlent surtout de la peur d’un envahissement de l’autre.
C’est intéressant de noter que plus elle considère l’autre comme appartenant à la catégorie des pauvres, des malades et des clochards, plus elle a peur de la contamination. Pour autant il n’y a aucun critère objectif dans sa classification personnelle des gens fréquentables. Par exemple, elle trouve que ça sent chez elle, la pisse de son voisin qui est assez propre mais traîne ses guêtres chez un ami franchement peu pointilleux en matière d’hygiène. Ce sont les affects qui gouvernent ses représentations du sale et du propre. Elle oscille donc perpétuellement entre troubles du comportement et attitude adaptée. Nous avons cessé la méthode du rappel au cadre pour travailler la question de l’attachement.
Nous lui avons accordé des privilèges afin de l’aider à exister dans le groupe, à trouver la place qui lui convenait, à apaiser ses angoisses de disparition. Plutôt que d’essayer de diminuer ses troubles, je les ai utilisés pour créer du lien à partir de sa singularité. Le déroulement des repas collectifs illustre bien la posture choisie. Je mangeais toujours à côté d’elle, je partageais le pain qu’elle ramenait pour ne pas avoir à partager le pain collectif, je finissais son assiette quand elle n’avait plus faim. Elle me regardait prendre sa nourriture avec ma fourchette et en référence à son incapacité à supporter les microbes des autres, elle disait toujours : « tu me crains pas, hein ». Elle était alors parfaitement rassurée d’être reconnue comme plus propre que les autres. Comme elle ne prenait jamais le café ordinaire, je gardais toujours des sticks dans mon tiroir de bureau. Nous le buvions toutes les deux en dehors des horaires du temps café. C’est intéressant de noter que les autres résidents s’accommodaient parfaitement de ces petits aménagements. Il faut dire qu’ils avaient beaucoup d’empathie pour Christine et qu’ils étaient les premiers bénéficiaires de l’amélioration de la situation. Les crises s’espaçaient. Je crois surtout que c’est rassurant d’être témoin de bienveillance. Il me semble que les autres se sentaient eux même bien traités quand je prenais le temps d’accueillir Christine dans sa folie. Je savais que pour certains être reconnu impliquait surtout de me tenir en retrait. Ce qui était aussi une manière de prendre en compte leur singularité, car la violence institutionnelle ressentie par les usagers se porte parfois sur cette impression d’être perpétuellement quiconque.
L’histoire de Christine est intéressante parce qu’elle illustre qu’il existe une correspondance possible entre hygiène du corps, hygiène de l’habitat et capacité à être en lien avec soi et avec l’autre. C’est en s’adressant à la personne singulière qui se loge derrière le symptôme que nous avons pu cheminer ensemble vers un aménagement rendant supportable le quotidien. Dans « Bâtir Habiter Penser », Heidegger nous dit : « L’homme du tracteur devant ses remorques se sent chez lui sur l’autostrade, mais il n’y loge pas ; l’ouvrière se sent chez elle dans la filature, pourtant elle n’y a pas son habitation ; l’ingénieur qui dirige la centrale électrique s’y trouve chez lui, mais il n’y habite pas. Ces bâtiments donnent une demeure à l’homme. Il les habite et pourtant il n’y habite pas, si habiter veut dire seulement que nous occupons un logis. »
Les intervenants sociaux qui accompagnent les grands exclus tentent de faire se rejoindre les lieux de vie et le sentiment d’être chez soi, dans le but d’atténuer les symptômes relatifs à l’errance psychique et sociale. Situation paradoxale puisque la plupart de ces lieux de vie ne sont pas choisis et sont liés à des dispositifs d’habitat temporaire. Toute la difficulté réside dans l’accompagnement à l’attachement pour rendre possible le détachement.
Bibliographie :
BACHELARD, Gaston. (1957). La poétique de l’espace. Paris : Quadrige, PUF, 215 p.
HEIDEGGER, Martin (1958). Bâtir, Habiter, Penser. In Essais et conférences. Paris : Gallimard, p. 224-225