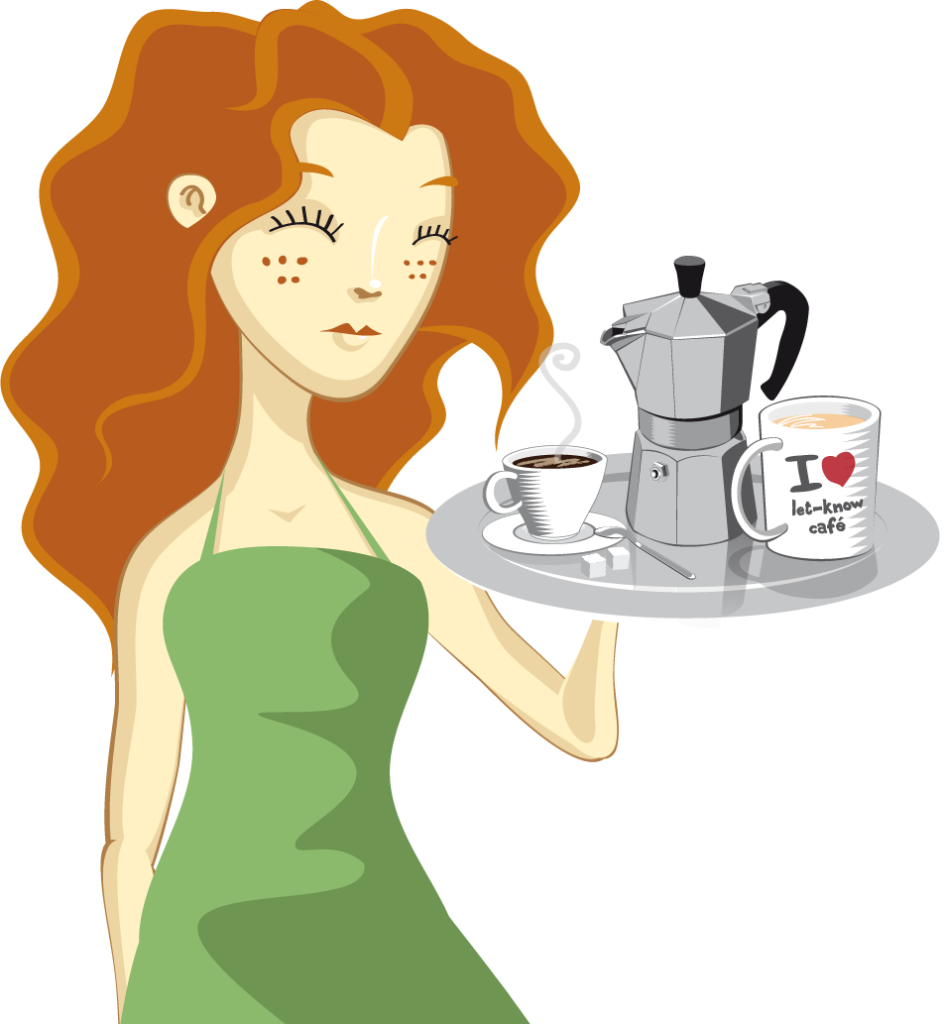Le dandinement des pissenlits
Jean Faya
3 avril 2020
C’est le matin du vendredi 3 avril. 7h15. Je viens de prendre rapidement mon petit déjeuner comme tous les jours de la semaine. Je passe le pas de la porte de notre maison. Je ferme le verrou du bas avec la clef. Je me lance dans la rue. Je ne suis donc pas confiné, pas enfermé entre les quatre murs de mon logement au fil des jours de la semaine. Certains pourraient me voir comme un soldat du front de la guerre macronienne. Moi, je sais juste que je suis médecin et que je suis pris bien malgré moi, dans cette drôle de situation. Le Covid 19 continue de foutre le bordel sur la planète. Et nous voilà tous chamboulés.
Je pars donc dans la rue, ce matin, comme tous les matins depuis le confinement, et comme ceux d’avant notre situation. Ce qui a changé entre les deux moments, c’est le calme, le vide, le peu de personnes, l’absence de voitures. Il y a si peu d’humains que je peux identifier chacun de ceux que je croise. Il y a l’homme chargé du ménage d’un grand immeuble à deux pas. Quand je passe, il s’occupe de nettoyer les poubelles et le rez-de-chaussée de son immeuble. Il a 55 ans, je pense, la petite moustache, le ventre rond. Nous nous disons bonjour. Puis en chemin vers le parc de la Tête d’or, je croise une femme d’une cinquantaine d’années, assez forte, très concentrée à promener son chien. Elle ne semble pas me voir. En longeant le parc, je me fais dépasser chaque jour à la même heure, par une cycliste. Je me dis qu’elle est infirmière et qu’elle se presse à aller astiquer les sondes d’intubation à l’hôpital de la Croix-Rousse. Elle a peut-être trente ans, la silhouette élégante, le bas du dos tellement cambré sur sa machine qu’il doit être bien agréable d’être sa selle. Au même instant, dans l’autre sens, un cycliste de 65 ans passe en costard, sur un vélo électrique, à fond les manettes et sans casque. Je ne peux m’empêcher d’imaginer comment se répandraient sur le sol ses mille morceaux s’il venait à s’éclater en tombant sur la chaussée, vu sa vitesse et son apparente fragilité. Un peu plus loin, je croise une femme grisonnante de 60 ans, qui marche d’un pas rapide pour faire son sport. Elle me dévisage à chaque fois avec un air amusé. Là, je fais mine d’éviter son regard. Et puis, toujours le long du parc, un artisan est derrière son Renault Trafic, coffre ouvert, pots de peinture prêts à l’emploi. Il regarde à chacun de mes passages, hilare, une vidéo sur son smart phone. Cela donne envie de voir par-dessus son épaule. Je croise au niveau des grilles du milieu du parc une joggeuse blanche et trop fine et un joggeur noir et trop musclé, tellement qu’il est obligé d’écarter un peu ses jambes pour que ses cuisses ne butent pas l’une contre l’autre à chaque foulée. La joggeuse évite mon regard, et avec le joggeur nous nous disons bonjour. Plus loin sur le quai du Rhône, il y aura celui qui m’intrigue le plus, ce cycliste avec sa parka orange qui stoppe son vélo juste sous la trémie et qui, assis sur le muret est archiconcentré à écrire un message sur son téléphone. Tous les jours, il s’arrête là pour écrire. C’est extraordinaire. Pourquoi là, juste à cet endroit le moins agréable des quais, je trouve… J’espère qu’il écrit à son amour. Et moi, pour tous ceux-là, je suis le drôle de bonhomme, le corps un peu voûté, la veste grise, tête dans la capuche, qui marche d’un bon pas tout en lisant un livre jaune. C’est, je crois, ce qui fait sourire la dame aux cheveux gris.
Ce chemin pourrait être agréable. Cette rareté des rencontres pourrait les rendre savoureuses. La chaleur devient douce en cette saison. L’air est frais et souvent le soleil pointe déjà ses premiers rayons. Tout cela pourrait être le privilège d’un non confiné, et pourtant, je suis vidé de tout sentiment de liberté ou de quiétude. Je me sens entravé et inquiet. Je suis un confiné d’un autre genre. Un jour, il y a trois semaines, je suis arrivé à la hauteur de la première grille du parc. J’avais l’habitude de la franchir pour rentrer dans cet endroit fait le matin de brume et de biches, de m’asseoir toujours au pied du même arbre en tailleur sur un petit carré d’une toile cirée à fleurs, pour travailler ma connexion avec le monde, la conscience de mon souffle, de mon corps, des pensées qui vont et qui viennent essayant de me distraire, du vent léger, du soleil qui se lève, de l’oie ou du chien qui se présentent, des bruits au loin de la ville ou des oiseaux du coin, de l’amour pour les miens. Mais il y a trois semaines, la grille était fermée, comme toutes les autres grilles. « Pour raison de sécurité ». Cette grille fermée, c’était le début de mon enfermement, du confinement de ma conscience.
Privée de son arbre, ma conscience était privée d’un repère important, d’une habitude, d’un monde doux et de moments de profond plaisir. Mais la perte de cet espace n’est pas ma seule difficulté. Trois pensées molosses se mettent en moi, à grossir de plus en plus, à tenir une place bien trop forte pour des pensées. Elles s’installent dans mon cerveau, comme le copain lourdingue sur le canapé du salon avec de la bière et des chips, qui parle trop fort, et qui ne comprend pas que là il faut partir parce que je souhaite aller me coucher. Non seulement ces trois molosses squattent mon cerveau, mais forts et solides, ils le contiennent presque, confinent ma raison plaquée au fond contre ma boîte crânienne.
Le premier molosse qui est apparu et qui a pris de la force progressivement depuis le mois de janvier est celui du déni. C’est celui qui voit le Coronavirus comme une grippette, et les mesures sociales et politiques comme une hystérie collective. Cette bête-là ne me lâche pas, me fatigue, envahit mes conversations et mes rencontres, même si elle perd peut-être ces jours-ci un peu de vigueur. Le deuxième molosse est un molosse intéressé. L’activité de mon cabinet étant divisée par deux depuis deux semaines, il craint pour les sous, il rapporte sans cesse l’inconfort, le manque, la pénurie, le matelas qui s’étiole. Et le troisième molosse est peut-être celui qui me fait le plus mal depuis quelques jours, qui se dispute sans cesse avec le premier, qui prend le dessus dans ce moment. C’est celui qui est obsédé par la contagion, la maladie et la mort qui rôde qui tourne là autour dans cette histoire. Il a pris de l’assurance depuis que j’ai envoyé ce cher Marcel, de 3 ans mon cadet, se faire intuber dans la trachée, par la sonde astiquée de l’infirmière au bas du dos si cambré sur sa selle. Il a pris de la confiance depuis que par un coup de fil au 15, j’ai fait emporter Lumina, sa fille de 20 ans, pleine de son bébé à naître, vers les soins intensifs. Le virus à l’œuvre, juste devant moi, moi juste à portée de lui, donne une assurance pénible à cette troisième bête, celle qui voit la mort juste là, à chercher celui qu’elle va saisir. Si Marcel est entre la vie et la mort, pourquoi ne suivrais-je pas moi la même voie ?
Ce sont ces trois pensées molossoïdes qui font mon confinement. Elles étouffent depuis trois semaines mon esprit. Au départ, elles m’envahissaient complètement, prenaient même mon sommeil. J’avais un réveil à l’envers le matin, où je ne me disais non pas « Ouf, ce n’était cette nuit qu’un cauchemar », mais « Oh non, le cauchemar est à venir aujourd’hui ». Pendant les premiers jours, je me suis senti perdre pied, ou plutôt perdre les rênes de mon esprit, de mes pensées. J’essayais juste tant bien que mal de suivre mon rôle dans cette folle histoire virale. Les molosses s’en donnaient à cœur joie.
Un matin, je me suis dit que oui, j’avais perdu le fil, et que ce n’était pas bon. Alors j’ai discrètement élaboré un plan, genre la grande évasion. Il fallait que je reprenne les rênes de ma pensée, que j’arrive à donner du lâche à l’étreinte des trois molossoïdes, que je me déconfine. Il y avait un livre jaune sur mon bureau, un livre dont j’avais l’intuition qu’il serait autant difficile à lire que central pour ma vie cérébrale. Je me demandais depuis des semaines à quel moment j’arriverais à libérer de l’énergie et de la disponibilité pour m’attaquer à un tel ouvrage. Et bien tel l’aventurier qui se lance un défi, je me suis dit : c’est maintenant, c’est là dans ce moment peut-être le plus incertain de mon existence que je vais me forcer à lire dix pages par jour de ce bouquin et tenir ainsi en respect autant que possible les trois bêtes. Et c’est ainsi que, une fois mon corps déconfiné le matin de mon logis, je tente de déconfiner ma pensée par la lecture des Méditations cartésiennes d’Edmond Husserl.
J’ai réussi à tenir le rythme, à suivre le sens de ce livre difficile, à prendre quelques notes sur mes lectures une fois arrivé devant l’ordinateur de mon cabinet. Mais il y a eu bon nombre d’instants de lassitude. Assez intenses parfois, comme ce matin où je tente comme tous les matins depuis le confinement, une séance de méditation sur le mur des quais du Rhône, à la façon dont je le faisais au pied de l’arbre du parc. Mais alors qu’au pied de l’arbre, je contemplais amusé l’irruption de quelques pensées à droite et à gauche, auxquelles je demandais d’attendre gentiment un temps plus propice pour que je m’occupe d’elles, là sur les quais, sans cesse, les trois molosses reviennent à la charge. Le Déni, l’Intérêt, et la Mort, à tour de rôle me confinent encore, toujours dans mon cerveau, et seuls quelques brins de conscience arrivent à s’échapper. Ce matin, je capitule au bout de cinq minutes, quand les jours précédents, c’était au bout de dix. À quoi bon je me dis. À quoi bon se faire chier à lire Husserl, à s’obstiner à dompter ces pensées. Pourquoi ne pas se laisser aller, se livrer au coronavirus, et s’abandonner en espérant qu’un jour cela passe. Dans cet instant d’abandon, au lieu de me relever et de me remettre en route vers mon cabinet et les infectés, sans conscience, je laisse aller mon regard juste un petit temps sur ce qui m’environne, les grands arbres d’où chantent les oiseaux, le soleil qui se reflète entre eux dans l’eau paisible du Rhône, les immeubles colorés de la Croix-Rousse pleins à craquer sûrement de confinés invisibles. Et mon regard se pose machinalement sur le mur du quai en pente abrupte où je suis assis, qui surplombe la promenade pour les cyclistes et les piétons, déserte, car fermée au public. Et là, je vois m’apparaître entre les pierres cimentées de ce mur, des centaines de fleurs de pissenlits, juste fanées pour être prêtes à lancer leurs graines à la volée. Et ces fleurs, figure-toi, se dandinent toutes ensemble au rythme d’une brise très légère et semble-t-il saccadée, que seules elles peuvent saisir. Cette danse-là, dans une mesure complètement synchronisée, est presque drôle, comme la chorégraphie des personnages d’un dessin animé. Je souris surpris et amusé de ce spectacle, et puis je me demande : mais à quoi bon, à quoi bon avoir fait tout ce travail entre chacune de ces pierres pour que le produit de cet incroyable effort finisse là, en un tas cotonneux, coincé entre le ciment du mur et le bitume de la piste cyclable. Oui, à quoi bon… À quoi bon ? Ben, me disent les fleurs fanées, juste à la beauté d’être. Juste au plaisir de participer au mouvement du monde. Juste au plaisir d’être une fleur, un esprit. Juste au plaisir de faire un doigt d’honneur aux trois molossoïdes, ou aux deux pierres et à leurs joints de ciment. Juste à l’intention, celle de se laisser porter par la brise du matin ou par celle du vent de la pensée, l’intention d’exister.
Alors, oui, je repars sur le quai heureux, invitant mes deux fesses à imiter le dandinement des pissenlits, proposant à ma main droite de présenter à mes deux yeux le texte des méditations cartésiennes de Husserl, encourageant mes deux pieds à entamer la marche vers le Coronaland. Joyeux bordel ! Coronavirée !
Lucas M.