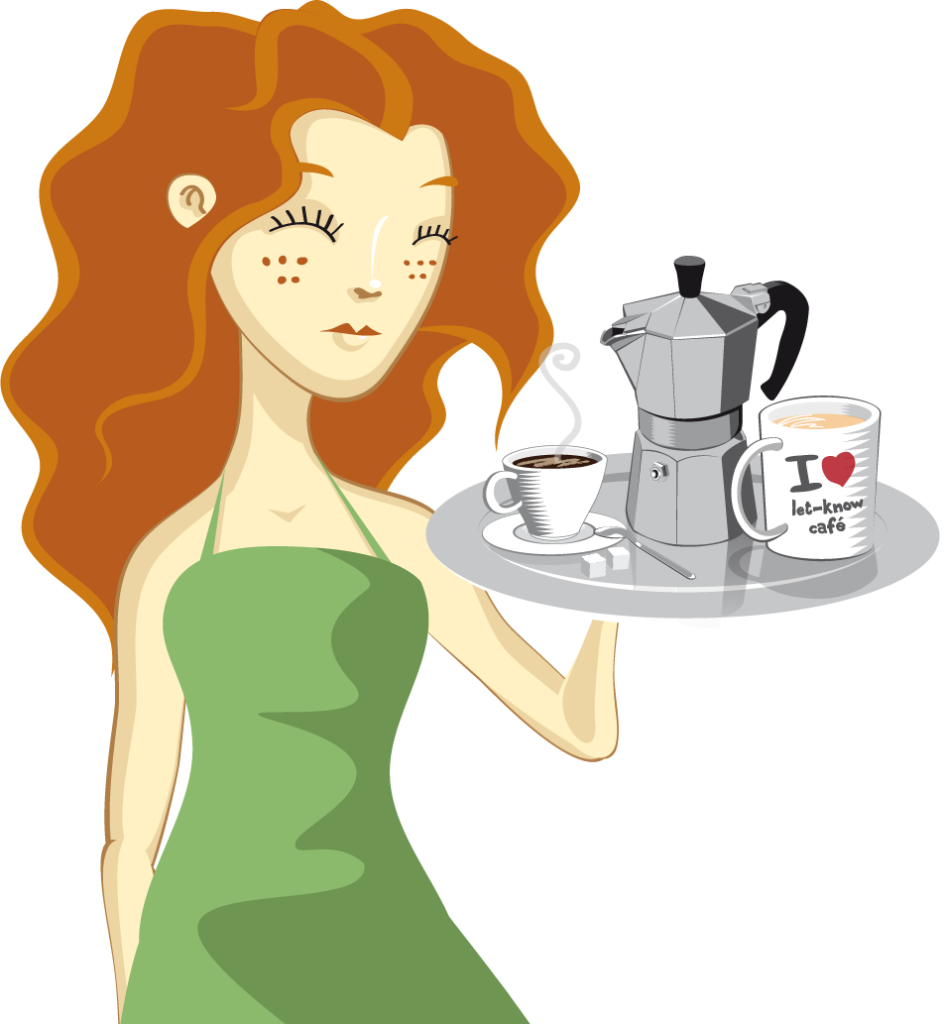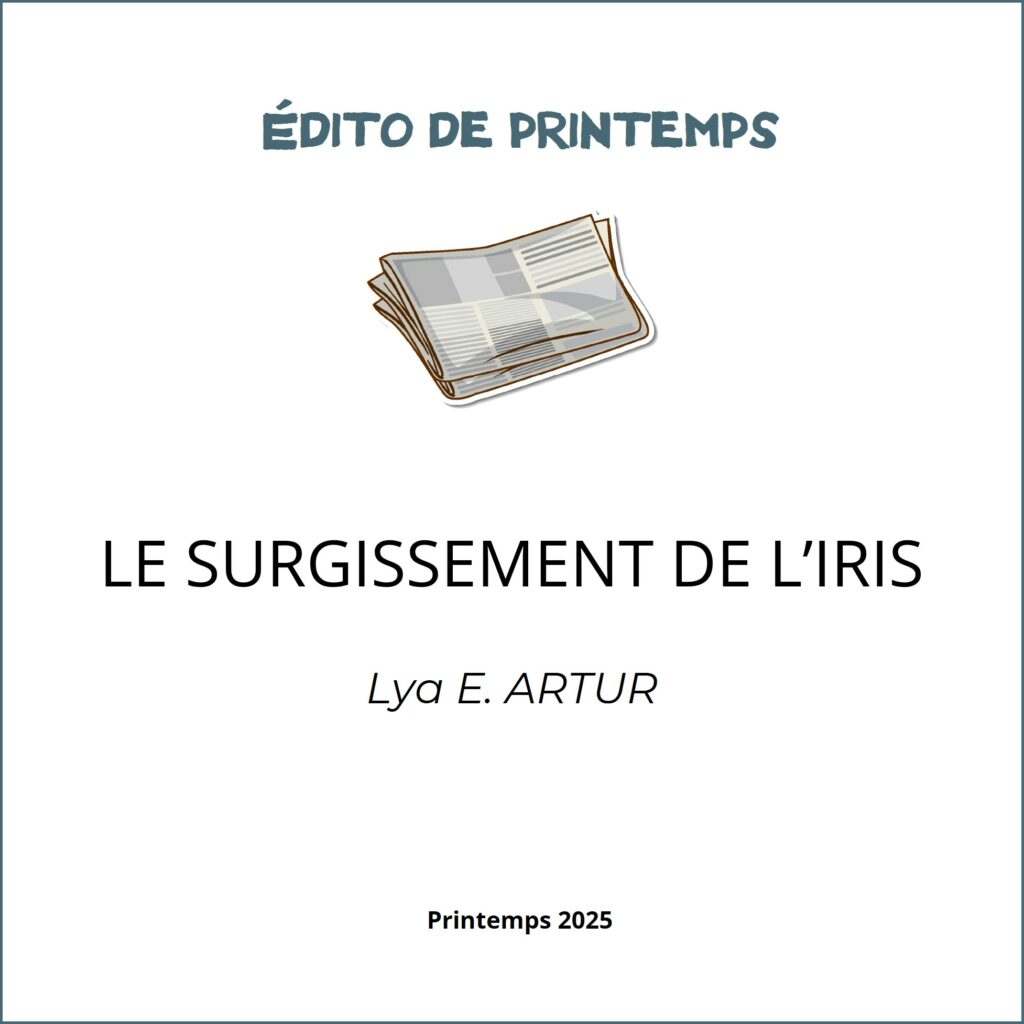
Le surgissement de l'iris
Lya E. ARTUR
Printemps 2025
De nouveau les jours s’allongent, et partout nous assistons à des explosions miniatures, à une symphonie de couleurs vives, jaune acide, vert menthe, rouge cochenille. Partout, nous assistons au chaos savamment orchestré du printemps. Une fois encore, les oiseaux commencent à siffloter sur leurs branches, messagers infatigables qui empilent « des colliers de son dont la durée fait quelques secondes[1] » ; partout des ondes de lumière satinées se répandent sur la terre et les herbes rases, et de courageux insectes s’apprêtent à s’activer, butiner, perpétuer le cycle infini des éclosions saisonnières.
« Le Tympan joue au plus fin,
L’iris ressemble au transparent,
Le Sens est sans orientation. »
« Ou donc es-tu , toi qui interroges ton absence ?
As-tu pensé ton surgissement ?
Savais-tu que surgir c’est changer ? Maintenant ? [2]»
La vie surgit, neuve, indéfinie encore. La lumière prend son départ, plus intense, vivace, précoce, elle redonne au sentiment de paraître une étrange et douce fondation. Nous regardons les fleurs naissantes comme les pensées les plus achevées de notre condition. Et confondu en elles nous visitions tous les lieux qu’habita jadis notre espèce.
Mais une mélodie plus grave et dissonante nous sort de la rêverie, car au loin nous entendons la rumeur inquiétante du monde, les tensions géopolitiques qui ne cessent de grandir et de semer la confusion dans nos esprits apeurés. Peu d’entre nous peuvent se vanter d’avoir échappé au matraquage médiatique de ces derniers mois. Peu d’entre nous ont réussi à esquiver ces flux d’informations qui donnent – inévitablement – le sentiment d’un danger imminent. Nous pourrions presque dire que l’Etat a désacralisé l’hiver, temps du repli et de la contemplation intérieure. Oui, l’hiver est peut-être la saison sur laquelle l’Etat a le mieux exercé son entreprise d’assèchement, où il est le plus présent dans nos esprits, car c’est une saison qui pousse les humains à se recroqueviller à l’intérieur des images, des murs, des écrans qui les séparent du monde. Et nous voici comme délogés de nos maisons infiltrées par l’angoisse ou la colère, tant il est difficile de fuir la propagande politique qui se glisse dans tous les interstices du discours et envahit même les débats littéraires ou philosophiques ; discours composés de chiffres, de clauses, de décrets, de coups d’états qui contaminent aussi bien la sphère publique que privée. L’Etat avec sa veulerie atomique et utilitaire nous ramène à une terre non-poétisée, dépoétisée ; réplication d’un tombeau dans la langue qui se déverse partout telle une feinte, un dessillement du rêve …. Et pour être certain que personne n’oublie la menace qui nous guette, nous recevrons bientôt un manuel de survie en cas de guerre. Même certaines figures contemporaines très influentes, qui nous promettaient une révolution poético-philosophique, ne savent plus que dispenser le ressentiment et le désenchantement aux jeunes générations, et n’incarne plus en aucune façon, à mon sens, l’idéalisme poétique qui nous mènerait vers le retournement attendu.
Prendre en charge la violence du monde sans devenir soi-même violent, discordant, voilà peut-être le véritable enjeu du « poélitique » que nous essayons d’ébaucher à Let-Know Café. En réalité, les combats politiques me semblent souvent secondaires, dérisoires et vains, si notre manière d’être ne reflète pas les qualités que nous prétendons défendre. Et bien souvent, nous cultivons des aspirations ou des convictions idéologiques qui demandent un degré de pureté morale que nous ne pouvons pas atteindre, ni dans nos modes de vie, ni dans nos liens avec les autres, et nous sommes pris dans une tension constante entre ce que nous pensons être juste et la manière dont nous agissons réellement, entre ce que nous aimerions être et ce qui émane réellement de nous. Aussi j’en suis venue à croire cela : l’un des plus grands défis que peut se lancer l’Homme à lui-même est de rester cohérent avec ses propres valeurs, de continuer à démasquer les contradictions qui divisent sa propre conscience, de regarder précisément comment il investit ses visions les plus hautes, non pas seulement dans des discours excités, mais dans des gestes simples du quotidien, dans des mots, des regards, des intentions, des actions, des émotions qui sont véhiculés tous les jours – dans tout ce que nous touchons d’une réalité humaine vivante, et qui passe, avant tout, par une lente et patiente alchimie avec ce.ux qui nous entoure, un tissage de liens plus ténus avec le réel. Le politique est partout, invasif – mais la véritable question se situe pour moi au cœur de notre intimité : quel ami sommes-nous, quelle mère, quel père, quel partenaire, quel voisin ? Comment traitons-nous les êtres qui nous sont proches, les lieux que nous habitons, et nous-même, comment sommes-nous capables de nous aimer et de nous respecter ? Où réside vraiment notre puissance humanisante ?
Bien sûr, s’engager dans une cause qui nous semble importante est nécessaire pour donner forme à nos visions, à condition, au final, de ne pas générer plus de pollution – émotionnelle ou autre – en voulant dépolluer le monde, mais peut-être faudrait-il ramener les choses à notre échelle, à des initiatives locales qui enclencheraient cette présence de proximité, construire des poches de résistance à taille humaine. Comment nous détacher suffisamment des rumeurs de la cité tout en continuant à demeurer vivant en elle ? Pascal Quignard dans sa critique du jugement disait que nous devrions « fonder un club antidémocratique fermé aux prêtres, aux magistrats, aux philosophes, aux politiques, aux éditorialistes. Il faut retourner à une diffusion plus solitaire et clandestine de l’œuvre d’art. »
J’ai eu l’occasion, récemment, d’assister à un événement bouddhiste qui rassemblait une trentaine de jeunes venus célébrer le dernier acte de transmission de Josei Toda à une nouvelle génération de disciples, qu’il avait réuni au pied du Mont Fuji, car il se savait mourant. N’étant pas pratiquante, je connais bien mal le bouddhisme de Nichiren et l’organisation que ce maître japonais a refondé sous le nom de Soka Gakkai. Je ne peux donc rien en dire de particulier, mais je peux tout de même évoquer les impressions furtives que m’ont laissées les échanges, les participants. L’une m’explique que ce mouvement est dépolitisé, que ce qui est visé au final, c’est une révolution pacifique qui repose sur le bonheur de chacun. Un autre me parle de ce principe vivifiant répandu dans le bouddhisme : pouvoir honorer la dignité de chaque vie. Un autre enfin me remet en cadeau un papier cartonné et joliment illustré sur lequel figure une pensée d’encouragement destinée à ma fille : « Le bouddhisme enseigne que nous pouvons écrire le scénario de notre vie. Ce n’est pas une force extérieure qui l’écrit, il n’est pas le résultat de coïncidences ni prédéterminé par le destin. » Je sens à quel point tous ces jeunes persistent à croire en la possibilité d’un monde plus solidaire, plus résilient, où la beauté, la bonté, la justice deviendraient notre héritage le plus précieux. Cela peut sembler naïf, à première vue. Mais de manière étonnante, chaque parole me semble porteuse d’un sens profond, car je sens une réelle adéquation entre les mots prononcés et la manière dont ils s’incarnent dans chacun de ces êtres, pas comme une idée flottante, une abstraction douteuse, mais comme une pulsation du sang dans un corps très habité. Et pour moi qui suis étrangère à ces pratiques, et, il faut l’admettre, souvent distante avec les mouvements spirituels, je dois reconnaître que la magie opère. Car tout au long de cette journée, j’ai ressenti une douceur inhabituelle qui ne demandait rien, qui se contentait d’être là, discrète, mais indéfectible, comme si j’avais en face de moi des captifs libérés qui avaient réussi à créer un intervalle de silence à l’intérieur d’eux-mêmes, un « vide médian » qui permettait à la respiration de s’installer, au souffle de circuler. Des êtres en présence, animés par leurs désirs, leurs projets, leur vitalité singulière, en charge de leur propre destin, et qui grandissaient chaque jour en fécondité et en créativité.
« Si chaque présence est une finitude, en revanche, entre les présences qui ne cessent d’échanger circule le souffle de l’infini. La beauté, par son pouvoir d’attraction, contribue à la constitution de l’ensemble de présences en un immense réseau de vie organique où tout se relie et se tient, où chaque unicité prend sens face aux autres unicités et, par-là, prend part au tout[3] »
Lya E. Artur
[1] Pascal Quignard, Une journée de bonheur, p.105
[2] Jean Mambrino, La saison du monde, L’interrogateur
[3] François Cheng, Œil ouvert et cœur battant, p. 23.