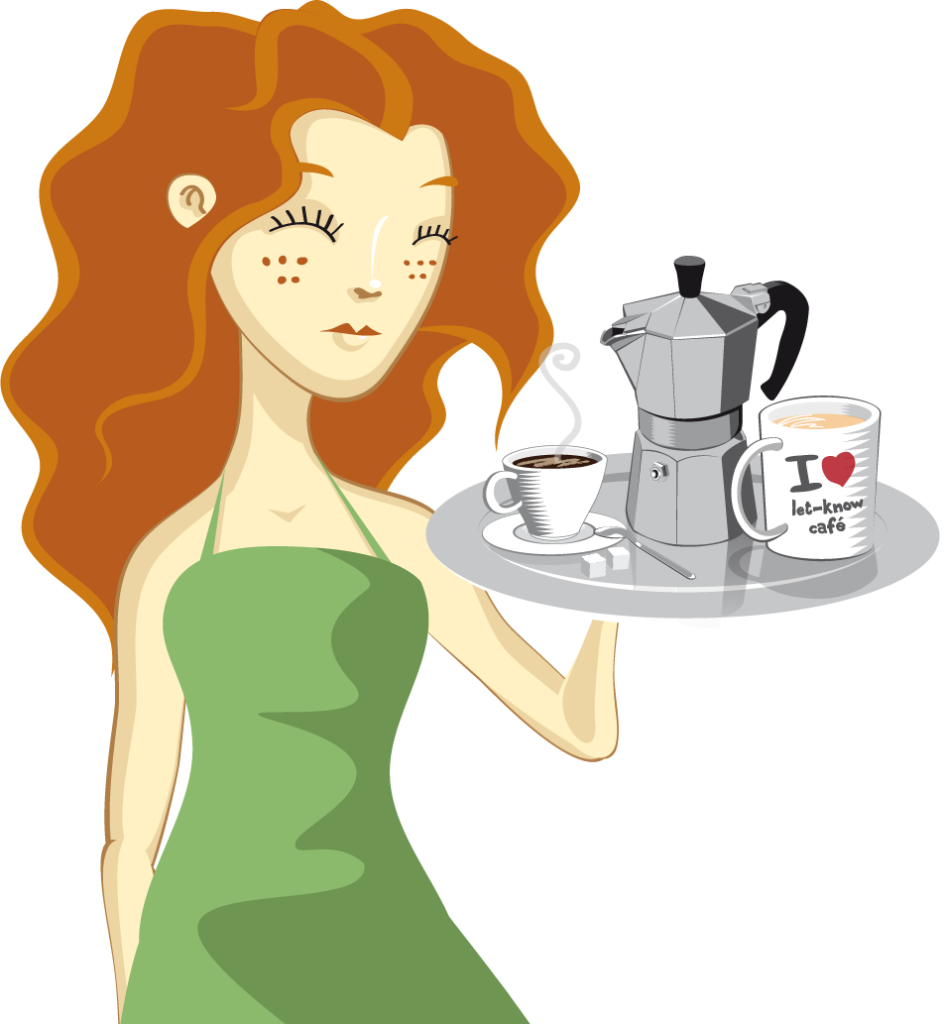L’avènement de l’âme transpercée
Lya E. Artur
3 décembre 2023
- « Tu ne m’écoutes pas »
L’une des voies que nous avons empruntées à Let-know Café est celle de la phénoménologie poétique.
La phénoménologie et le poétique sont intimement liés, dans le sens où ils cherchent à établir un rapport d’immédiateté au monde et à nous situer au plus près d’un lieu d’apparition. Dans une interview, Bruno Pinchard définit brièvement la phénoménologie de cette manière : il s’agit de « voir un objet sans aucun a priori pour lui donner le plus de possibilités sur le regard qu’on pose sur lui. Ouvrir les variations qui l’habitent » On retrouve ici une correspondance évidence avec la démarche poétique, qui pourrait impliquer la capacité à être saisi par une soudaineté, à se placer dans une absence d’évolution linéaire et expulser toute pensée préconçue pour laisser place à un surgissement instantané.
« L’image poétique n’a pas de passé proche le long duquel on pourrait suivre sa préparation et son avènement », nous dit Bachelard.
La poésie serait donc événement pur. Nous ne sommes plus ici dans un monde gouverné par la raison, par un esprit producteur de formes logiques, nous sommes comme éclairés par l’intuition que quelque chose « apparait » à notre conscience et se révèle à nous, dans l’instant, comme une fulgurance très habitée mais toujours transitoire. Cela peut être une apparition extérieure, une image qui entre par effraction dans nos yeux et nous révèle une portion du monde qui nous était inconnue, ou une apparition intérieure : je me réapparais moi-même à ma propre conscience.
La phénoménologie poétique nous invite alors à nous considérer comme un infini indéterminé.
Dans cette optique, nous pouvons envisager le travail du thérapeute comme un travail de déconstruction et d’abandon des présupposés, une manière d’entrer dans un nouveau mode de perception de l’être. C’est peut-être à cette condition que la rencontre peut avoir lieu, quand nous commençons à nous débarrasser des représentations mentales qui ont une fonction statique, et qui figent l’Autre dans une image donnée, une projection. D’ailleurs, cette manière de penser l’Autre à partir d’un modèle de référence intérieur, génère souvent de graves tensions et insatisfactions, puisque l’Autre se laisse rarement attraper comme un objet sans se débattre pour déjouer nos attentes et récupérer sa liberté d’être Autre, d’être Autrement.
Cette interview de George Brassens semble illustrer ce qui arrive quand un être se sent enfermé dans une image donnée, (dé)limitée, qui essaie de lui donner une forme déterminée avant même qu’il n’apparaisse dans sa réalité propre :
Georges BRASSENS : Tu sais, à force de réciter des poèmes en classe, et d’écouter des chansons, on voit à peu près comment ça se fabrique.
André SEVE : Mais tu as travaillé la versification ?
Georges BRASSENS : La plupart de ceux qui écrivent des chansons n’ont pas étudié la versification. […]
André SEVE : Toi, tu les as apprises ?
Georges BRASSENS : Oui, plus tard, parce que je raffinais un peu, mais…
André SEVE : Tu en as conservé de tes premières chansons ?
Georges BRASSENS : Non. On peut écrire des chansons sans… tu ne m’écoutes pas ?
André SEVE : Non, c’est parce que…
Georges BRASSENS : Tu suis ta pensée, je sens ça. Tu viens ici avec des idées préconçues et tu veux toujours suivre ton chemin, pas le mien.
Quand j’avance quelque part sur une idée, il faut me laisser partir et tu m’arrêtes. Là, j’aurais pu dire des choses mieux. Mais il faut le temps pour que ça vienne.
André SEVE : On y reviendra.
Georges BRASSENS : Il ne faut même pas dire qu’on y reviendra, il faut qu’on continue de parler, sans que tu t’occupes des questions que tu as fabriquées ou que toi, tu veux suivre. Veux-tu Brassens ou veux-tu fabriquer Brassens ? Si tu suis ton idée, tu perds ce que moi, en suivant ce qui me venait, j’allais te dire…
André SEVE : Les spécialistes n’ont pas su m’ouvrir à tes musiques, ni même tellement à tes textes.
Georges BRASSENS : Parce que toi, tu ne t’ouvres que si tu veux. Depuis que tu me questionnes, je le vois bien. Quand je t’explique quelque chose qui ne coïncide pas avec ce que tu voulais que je te dise, tu détournes la conversation.
André SEVE : Moins maintenant ? Après trois jours d’écoute.
Georges BRASSENS : « D’écoute », si on veut. Non, tu attends, tu attends, et quand ça coïncide avec ce que tu attends, pof, ça fait tilt, tu me regardes d’une façon vivante, tu es ouvert. Mais quand ça ne coïncide pas, je vois ton visage sans vie, je te surveille, tu sais, j’en apprends beaucoup sur toi en observant ton comportement d’interviewer. Tu arrives ici avec un Brassens entièrement préfabriqué dans ta petite tête et tu veux me faire entrer là-dedans. La seule chose qui t’intéresse, c’est de me faire dire ce que, d’après toi, Brassens doit dire, ce que Brassens doit être. Tu pourrais avoir le vrai Brassens, et en tout cas un Brassens inattendu. Mais tu t’es préparé au Brassens que tu veux. On attend toujours les êtres comme on les veut, on n’est pas prêt à la surprise.
- SEVE interroge Georges BRASSENS, le Centurion, Paris 1975.
Comme l’illustre bien cette interview de Georges Brassens, dès que nous entrons dans un conflit de représentations, dans une pensée abstraite où s’insinue la puissance d’une image préfabriquée, nous renonçons à toute surprise possible.
Je crois que la démarche poétique est une entreprise plus vaste de reconstruction des liens. Car elle augmente la surface de contact avec l’Autre et avec soi-même. Elle fait naître la présence de l’Autre, et elle nous fait naître à notre propre présence, car elle s’affirme en toute chose comme l’avènement d’une rencontre possible. Un endroit où l’on peut se rejoindre au plus intime en restant ouvert à la possibilité de l’Autre en tant qu’énigme, événement, surprise.
- L’acharnement des mouches
J’imagine que de nombreux soignants se sont un jour posé cette question : « mais qu’est ce qui rend les gens aussi malades ? »
Réponse impossible tant les facteurs sont variés, mais certains éléments récurrents peuvent attirer notre attention et guider notre réflexion, notamment l’inadéquation d’un individu avec son environnement, qu’il s’agisse d’un environnement affectif comme le couple ou la famille, ou d’un environnement professionnel. J’aimerais ici revenir sur ce dernier point, le professionnel, car c’est une situation courante, banale mais profondément aliénante qui me parait encore sous-estimée dans l’impact qu’elle peut avoir sur la qualité de vie.
Nous savons déjà que notre environnement a une influence vivace sur notre santé, et qu’un environnement inadéquat va constituer une grave entorse aux besoins naturels qui nous pilotent tous. Comme une plante qui aurait un pot trop petit pour ses racines, et qui finirait par se rabougrir et dépérir par manque d’espace. Lorsque nous ne sommes pas à notre place, nous mobilisons toutes notre énergie pour survivre à un milieu qui nous dévitalise. Nous vivons dans une dangereuse familiarité avec des habitudes qui ne permettent pas notre épanouissement, et qui finissent par devenir une camisole mentale. Chercher comment s’adapter à un environnement qui nous est toxique est une manœuvre éprouvante et relativement stérile, mais souvent, nous ne voyons pas d’issue positive et nous subissons passivement des situations parfois intenables. Plus nous essayons de nous accoutumer à un climat d’insécurité quotidien (ou d’ennui…), plus nous perdons notre précieuse énergie, et plus nous laissons grandir en nous un sentiment d’impuissance paralysant.
C’est alors que nous devenons « des mouches ». Des mouches qui frappent indéfiniment sur le même carreau pour essayer de retrouver une sortie, qui cognent de toutes leurs forces contre cette vitre qui leur fait obstacle, sans voir qu’une fenêtre est grande ouverte juste à côté, et qu’elles pourraient sortir à tout moment.
Quelles que soient les raisons qui nous poussent à rester dans une situation qui nous affecte, nous préférons souvent traiter le symptôme de l’angoisse plutôt que son origine. Par exemple, nous sommes tentés de prendre des médicaments contre la dépression plutôt que de démissionner d’un travail qui nous assomme, même si nous sommes en train de craquer nerveusement. Nous n’osons pas bouger car nous sommes transis de peur et de doutes (peur de nous tromper, de décevoir notre entourage, de quitter des habitudes qui finalement nous rassurent et posent un cadre contenant etc.). Nous choisissons alors de stagner dans le connu, dans un espèce de confort désastreux qui nous empêche de poser une décision saine et d’impulser de mouvement de sortie positif. Burn out, arrêt de travail et décrochage forcé peuvent ensuite s’enchaîner.
L’enjeu n’est-il pas alors de reconquérir un peu de terrain, de croire en la possibilité de se réinventer et de restaurer notre souveraineté. Mais encore faut-il accepter de laisser un vide à disposition, de faire ce saut effrayant mais salutaire dans l’inconnu pour goûter autrement notre existence. Encore faut-il provoquer la rupture et s’abandonner à une confiance amoureuse pour la vie, croire que les plus belles choses arrivent parfois par accident, de manière imprévisible.
- Faire ou défaire
La panique n’est jamais loin chez les personnes qui décident de quitter un emploi ou un projet qui les étouffe, et une question revient souvent dans leur bouche : « mais qu’est-ce que je vais faire de ma vie ? »
C’est une question d’autant plus anxiogène qu’elle est posée dans l’urgence, dans l’attente précipitée d’une réponse. Certaines personnes se sentent coupables de ne pas avoir une trajectoire de vie régulière, de ne pas savoir ce qu’elles « veulent faire » exactement. Elles imaginent que c’est une défectuosité personnelle et qu’elles ne devraient pas rester aussi longtemps dans le flou. Elles croient que la réponse devrait être innée, inhérente à leur nature, et qu’elles devraient tout connaître à l’avance, l’entièreté de leurs désirs. Pressées de « trouver leur voie » et de définir un objectif précis, elles finissent par poser le faire avant l’être, la destination avant le chemin, ce qui renforce inévitablement leurs difficultés à se positionner dans une vie plus ajustée pour elles. Car la question du « faire » devient seulement une question de performance ou de reconnaissance sociale quand elle n’est pas soutenue par un désir de réalisation profond et une intention claire.
Pour renouer avec la dimension sensible et organique du vivant (ce qui Jacques Maritain appelle peut-être « l’intuition poétique »), il me parait indispensable de se dégager des pressions et des influences extérieures qui écrasent notre volonté propre ; et de revendiquer pleinement notre autonomie, au risque de trahir les valeurs sociales, morales et familiales qui nous ont été inculquées. Ce n’est qu’à cette condition que nous pouvons assumer notre singularité, notre étrangeté.
Jacques Maritain nous disait que « L’intuition poétique vise l’existence concrète en tant que connaturelle à l’âme transpercée par une émotion donnée, c’est-à-dire qu’elle vise toujours un existant singulier, une réalité individuelle concrète et complexe, prise dans la violence de sa soudaine affirmation-de-soi et dans la totale unicité de son passage dans le temps »
Et souvenons-nous de Baudelaire, au moment de la publication de son recueil Les Fleurs du Mal, persuadé que l’art devait poursuivre un but étranger à la morale et que « la preuve de sa valeur positive est dans tout le mal qu’on en dit.»
- Être ou ne pas être
Pour résoudre la question du « faire », de nombreuses personnes se demandent « qui elles sont », partant du principe que « savoir qui je suis me permettra de déterminer ce que je vais faire ».
Pourtant, cette question identitaire amène souvent plus de tensions qu’elle n’en résout vraiment ; si l’on suppose que nous ne sommes qu’un assemblage de fragments prélevés à un instant donné, d’unités isolables, et qu’on ne peut accéder à une sorte de substrat fondamental qui définirait la totalité de ce que nous sommes. Si une telle essence existe, elle est peut-être comme le soleil, un astre invisible car trop éblouissant, inapprochable, mais qui vient révéler le monde à travers son rayonnement.
« On comprend ainsi que même dire : nous sommes des hommes, c’est n’exposer qu’une forme inauthentique, qu’il faut tenir pour assez provisoire. Nous n’avons aucun organe pour appréhender le Moi et le Nous, au contraire nous nous mettons nous-même dans la tâche aveugle, dans l’obscur de l’instant vécu, dont l’obscurité est en dernier ressort notre propre obscurité, notre être inconnu, notre être masqué, introuvable. Tout ce qui s’y trouve dilué provient de l’état présent du sujet, en tant que fonction de présence encore dispersée, sans unité ni centre, bien que n’abdiquant jamais. » (Ernst Bloch, l’esprit de l’utopie, p.244)
De fait, ne pourrait-on pas répondre à cette question du « qui je suis » par une réponse ouverte, comme « je suis ce que je suis », sous-entendu « je suis ce que je suis en train d’être à chaque instant » ?
Le risque de vouloir cerner son identité de trop près, est de s’enfermer dans une définition qui ne ferait que justifier ce que nous pensons être ou ce que nous voudrions être, en n’éclairant jamais qu’une seule version de nous. Là où il n’existe pas de frontières, pas de bornes, nous inventons une limite à l’expansion de notre être, nous sélectionnons un fragment, une image, que nous transformons en réalité absolue (par exemple, je suis quelqu’un de manuel, tout ce qui est intellectuel est donc exclu). Nous entrons ainsi dans un mode caricatural sans nuance, souvent marqué par une forme d’impureté à l’endroit de tout ce qui nous dérange.
Bien sûr, ce sentiment que nous « sommes quelque chose de fixe » nous aide à trouver un point d’ancrage dans une réalité mouvante qui ne se laisse jamais entièrement attraper, et chasse pour un temps nos doutes dans l’illusion de la stabilité. Mais cela ne nous dispense pas d’interroger ces discours et de remettre en cause leur légitimité, pour mieux comprendre le mode artificiel sur lequel ils fonctionnent. Car tout discours qui cherche à valider un angle de vue unique et à identifier une essence par nature insondable, peut menacer notre liberté d’être.
De fait, ne pourrait-on pas laisser aussi cette question de côté et entrer dans une poétique de l’inachevé – c’est-à-dire pouvoir être satisfait avec notre incomplétude, nos failles, nos boitillements et nos bégaiements, nos tâtonnements hasardeux et tout ce qui en nous est bancal, friable, inexplicable ? Pourquoi essayons-nous de déjouer le mystère plutôt que de le cultiver, de maîtriser le vivant plutôt que d’en libérer les forces créatrices ? Ce qui rend les choses si difficiles est peut-être que nous sommes dans le refus de l’opacité, que nous refusons de vivre dans la discontinuité, l’ébranlement perpétuel. Et j’admets que la tâche est ardue, qu’il est difficile d’accepter que tout ce qui nous est donné comme réel, comme vrai, comme durable peut s’écrouler à tout moment. C’est même une catastrophe existentielle. Mais c’est peut-être aussi l’instant béni où un nouveau bonheur peut survenir, où nous pouvons nous libérer de tout ce qui nous enjoint d’être accompli, parfaitement formé et défini pour commencer à nous réaliser dans notre être. La fragilité de l’existence, et l’extrême conscience de cette fragilité, peut nous en révéler la valeur absolue. Nous n’avons pas besoin de nous délester de nos peines ou de nos paradoxes pour toucher une sorte de noyau pur.
Christian Bobin disait : « La claire conscience de la vie, amenée par la calme pensée de sa fragilité, est la grâce même. […] quelque chose de fugace, d’infime, qui ne demande surtout pas à être retenu, et qui coïncide avec l’incorruptible joie d’être vivant. »
Ce que la poésie m’a permis de comprendre, c’est qu’il ne faut pas attendre d’être prêts pour commencer à vivre. Qu’il ne faut pas attendre d’avoir tout résolu en nous pour éprouver la grâce de l’instant. Que nous ne devons pas retarder les choses mais faire avec nos lacunes, nos hésitations, nos flottements et nos douleurs. Que nous ne pouvons pas attendre de nous sentir libres pour commencer à espérer une liberté possible. La plus grande illusion se situe peut-être ici – et c’est aussi une illusion thérapeutique -, dans cette croyance que tout doit être défroissé, aplani, aseptisé pour qu’une forme supérieure de l’être puisse émerger et que nous puissions enfin prétendre à la satiété du bonheur.
Quel est le rôle de la poésie ? C’est peut-être justement de prendre en charge tous les aspects de l’être, toutes les visions qui se chevauchent, se superposent, se contredisent. De permettre une intégration brute de tout ce que l’on est. L’être advient dans sa multitude foisonnante. À tout moment il peut se remettre à neuf, se réinventer et se surprendre. L’une des intentions du travail thérapeutique, notamment du travail psychanalytique si vous me permettez ce raccourci, est de venir éclairer des zones d’ombre, de nous en montrer le détail, de décortiquer notre esprit pour élucider nos souffrances et résoudre nos conflits intérieurs, de « gratter » notre histoire pour en retirer les impuretés… Au contraire, la poésie n’est pas là pour apporter un éclairage sur la compréhension, elle permet de faire exister des choses qui restent non éclairés par l’analyse, le calcul, ou le découpage de la conscience, elle permet de laisser telle quel ces zones de pénombre et de les porter à la lumière mais dans leur nuit ; elle donne une forme à ces ombres, ces sonorités, ces couleurs, et c’est peut-être là qu’apparait l’être dans toute sa clarté car il a conservé intact son mystère. La poésie permet de figurer l’infigurable.
En évoquant sa démarche artistique, Marguerite Duras disait : « le cinéma que je fais, je le fais au même endroit que mes livres, c’est ce que j’appelle, l’endroit de la passion. Là où on est sourd et aveugle… J’essaie d’être là le plus qu’il est possible ».
Et Yves Bonnefoy, dans L’improbable et autres essais, nous confie ces mots :
« Je dédie ce livre à l’improbable, c’est-à-dire à tout ce qui est.
A un esprit de veille. Aux théologies négatives. A une poésie désirée, de pluies, d’attente et de vent.
A un grand réalisme, qui aggrave au lieu de résoudre, qui désigne l’obscur, qui tienne les clartés pour nuées toujours déchirables. Qui ait souci d’une haute et impraticable clarté. »
- La connaissance par l’affect
C’est peut-être une autre région de l’être qu’il faut ouvrir pour faire des choix éclairés, une dimension plus élémentaire : celle de la joie. Donner une direction à mon existence à partir de la joie que je ressens, me semble être un repère bien plus fiable que la question du « que faire » ou du « qui suis-je ».
Comment pouvons-nous préserver ce lien vital qui nous relie à des aspirations fécondes ? Qu’est ce qui me donne de la joie ?
Si nous pouvions trouver un point d’attraction dans une vibration de joie, assez profonde pour nous donner un intérêt nouveau pour le monde, nous pourrions comprendre ce qui nous anime avec le plus d’ardeur, quel désir nous pousse à devenir plus grand que nous-même et nous motive à regarder plus loin que nos propres limites. A quel moment la joie nous vient, advient ?
Il n’est pas facile de répondre à cette question, qui peut sembler d’une simplicité enfantine. Encore faut-il accepter de ne pas trouver ce qu’on cherchait et de laisser surgir l’étonnement dans toute sa merveilleuse naïveté. Encore faut-il résister à l’écrasement du sensible en nous et se rendre disponible à une émotion qui échappe à toute logique et à toute cohérence (la joie), sans chercher à prouver ou démontrer qu’elle est valable.
« Aussi sublime donc que soit l’incitation de cet état d’étonnement, de pressentiment, il n’en rencontre pas moins en chemin, non seulement dans son intention « inconsciente » qui peut se ramener à ce qui n’est simplement « plus conscient », mais précisément aussi dans son adéquation, du côté de son objet, quantité de solution illusoires qui en arrêtent l’élan, qui façonnent sans fin des formes stables, gaspillant et nivelant ainsi l’excédent utopique dans cette existence qui est la nôtre. » (Ernst bloch)
Quand on leur demande de nous décrire ce qu’elles ressentent, de nombreuses personnes répondent par l’analyse, car elles cherchent encore une solution et non une sensation. Or, j’ai souvent constaté que les édifices conceptuels amènent un certain degré de complications, de confusion, et repoussent toujours plus loin la réponse, comme une balle qu’on ne parviendrait pas à saisir et qui serait constamment éjectée à l’autre bout de la pièce.
Sentir ce qui nous « met en joie » ne demande aucune contorsion de l’esprit, c’est une opération magique qui convoque des instincts puissants. Cette « connaissance par l’affect » comme on pourrait l’appeler, suppose de contacter ce qui est le plus vivant en nous, d’investir l’endroit où on se sent exister vraiment, viscéralement, où on s’autorise à écouter des évidences très simples, directes, éblouissantes de vérité.
Bien qu’il existe un large spectre de réponses possibles à cette question centrale, j’ai souvent remarqué que des éléments se recoupaient d’une personne à l’autre, comme la contemplation esthétique (la beauté), le tissage des liens humains ou non humains (l’être ensemble), l’activité artistique (la création), etc. Finalement, ce qui semble procurer le plus de joie à un être et réparer quelque chose de son humanité n’est pas étranger à la poésie. Bien au contraire, c’est peut-être ce qu’elle défend avec le plus d’ardeur car elle reconnait aussi son extrême fragilité. Car la beauté s’abime facilement quand on ne lui donne pas tous les soins qu’elle mérite, quand on ne la visite plus aux heures sombres pour la porter dans la lumière – et c’est une tâche infinie que de la protéger contre les négligences qui nous privent de son intelligence infatigable.
« Nous n’entendons que nous-mêmes.
Car nous devenons progressivement aveugles au monde extérieur.
Quelque forme que nous produisions par ailleurs, de nous elle refait le tour. Elle n’est pas notre Moi exact, sans plus ; elle n’est pas exactement aussi brumeuse, aérienne, chaude, obscure, immatérielle que le sentiment de n’être jamais qu’auprès de soi, de n’être jamais que conscient. Elle est une substance et une expérience aux liens étrangers. Mais nous allons dans la forêt, et notre sensibilité s’émeut : nous sommes, nous pourrions être ce que rêve la forêt. Entre la colonnade de ses troncs nous allons, petits, spiritualisés, invisibles à nous-mêmes, nous sommes son chant, nous sommes ce qui ne pourrait redevenir forêt, jour extérieur, visibilité. L’être ou le sens de toutes ces mousses, ces fleurs étranges, ces racines, ces troncs et ces rais de lumière qui nous entourent nous échappe, parce que nous le sommes nous-mêmes, et que nous nous tenons trop prêts de cette expérience fantomatique et si indicible encore qu’est la conscience ou le cheminement intérieur. »
Ernst bloch, l’esprit de l’utopie p.50