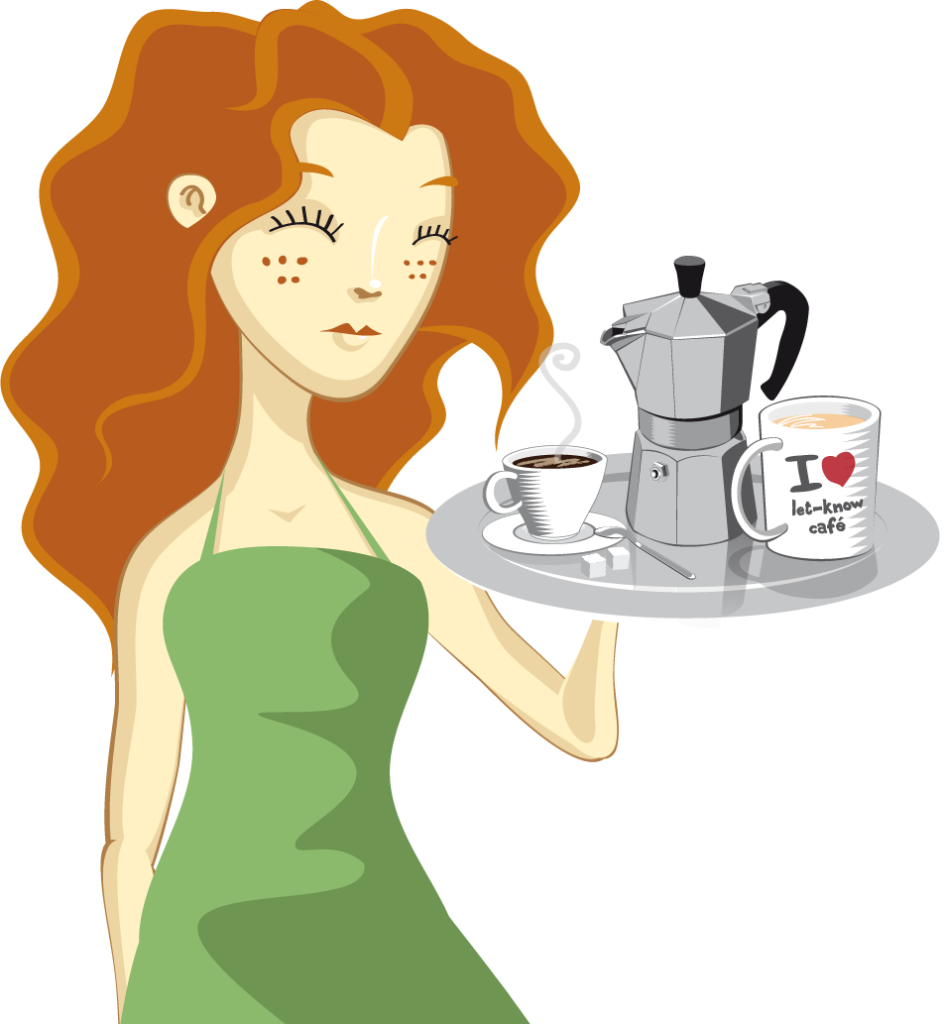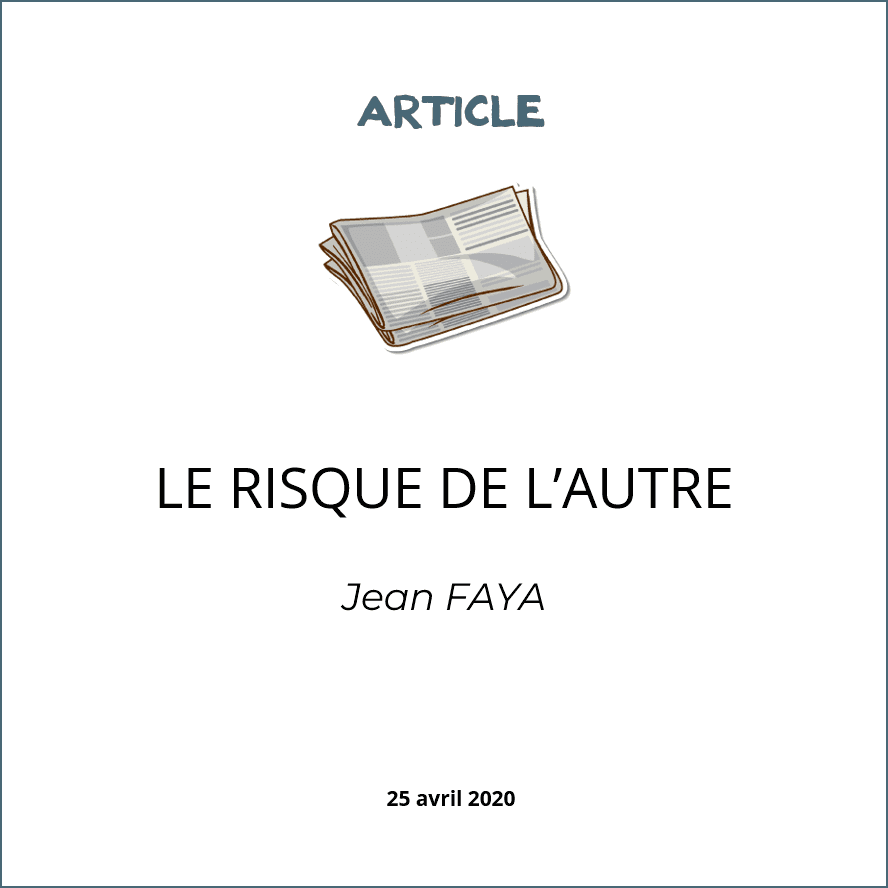
Le risque de l'autre
Jean Faya
25 avril 2020
Cher Coronavirus,
Nous sommes le samedi 25 avril 2020. Je commence, à l’occasion de mes congés annuels, ma première et unique semaine de confinement quand les autres sont confinés depuis plus d’un mois. C’est l’occasion de rédiger ce texte en réponse à l’appel à écrire de Let-Know Café. Alors c’est à toi que je m’adresse virus, toi qui mets le monde et les hommes sens dessus dessous. Je m’adresse à toi même si tu n’es qu’un pauvre virus, une pauvre chose qui n’a sûrement que peu de conscience du bazar qu’elle engendre. Tu as au mieux juste le souci de te reproduire, de vivre ta vie selon je ne sais quel programme génétique fourré dans les hélices de ta couronne. Mais la pauvre chose que tu es est devenue en quelques semaines la chose première, la préoccupation essentielle et commune à tous les humains de la planète. Tu es devenu la chose publique. Tu instaures ta république et nous tentons de comprendre ce qui nous arrive.
J’ai entendu parler de toi pour la première fois au mois de décembre 2019. L’information arrive qu’un virus nouveau semble apparaître en Chine, dans la ville de Wuhan, un nouveau SRAS. Je me disais justement à cette période que cela faisait longtemps que l’on ne s’était pas fait peur collectivement, depuis les derniers épisodes de la grippe H1N1 de 2009, depuis la crainte de la propagation mondiale du virus Ebola en 2014. Nous sommes en 2020, la récurrence des cinq années sonne ton arrivée. Il semble que tu sois apparu sur le marché de gros de fruits de mer de Huanan. Un marché de gros, toi qui es si petit. À ce qu’il paraît, on trouve aussi dans ce marché bien d’autres animaux sauvages. L’affaire est confuse. Tu viendrais d’une chauve-souris, ou peut-être du pangolin. Quel drôle d’animal que celui-là, qui semble tout doux avec pourtant des écailles comme une armure, un bon cheval de Troie pour toi !
J’ai suivi ta propagation avec une grande attention. J’adore les virus de ton genre, et particulièrement celui qui nous est le plus familier, le virus de la grippe. Chaque hiver, j’attends avec impatience le mercredi, jour de l’actualisation hebdomadaire du bulletin du réseau Sentinelles, qui collecte les prélèvements d’un millier de médecins disséminés sur le territoire national. Il se crée à coup d’écouvillons nasals, une cartographie assez fidèle de l’évolution de l’épidémie. On la voit s’installer tranquillement au fil des semaines, on croit que ça débute, et non en fait tout reste calme. Le virus de la grippe va et vient, et semble nous narguer. Et tout à coup, c’est le grand démarrage ! Au cabinet d’abord. L’activité augmente subitement d’un tiers les bonnes années. Et comme mon temps de travail n’a pas la même capacité d’adaptation, ça coince, ça se bouscule. C’est le moment le plus rude de ma pratique. L’enfer de la grippe en France : 2 à 6 millions de malades, 5 à 15.000 morts par an.
Toi à côté, au mois de janvier, tu fais figure de petit joueur. Les médias commencent à compter les victimes. Ça va tout doux. Si la Chine dit vrai, le nombre de décès reste modeste. Le 20 janvier 2020, le président chinois Xi Jinping s’exprime pour la première fois à ton sujet et déclare que tu dois être pris au sérieux. Zhong Nanshan, épidémiologiste réputé, annonce publiquement que tu es transmissible d’être humain à être humain. Le 23 janvier, les habitants de Wuhan, soit 11 millions d’habitants, sont confinés. La ville est coupée du monde. En quarantaine. Je me dis que les Chinois n’y vont pas de main morte. Quelle mesure radicale face à toi qui sembles évoluer nettement moins sévèrement que la grippe ! Les médias parlent de plus en plus de toi. On commence à dire que tu pourrais arriver en France. Une anxiété s’installe. Le 24 janvier, trois premiers cas sont recensés sur le territoire national, dont un à Bordeaux. J’envoie un texto à des amis du coin chez qui nous venons de passer les fêtes de fin d’année : « Bon courage pour le confinement, les Bordelais, je vous amènerai des oranges ! » Je trouve ça drôle. J’ai l’impression qu’une nouvelle hystérie collective est en train de se constituer. Mais je suis médecin généraliste. Les épidémies, c’est aussi mon travail. Du coup, je commence quand même à penser à mon matériel, mes stocks, au cas où. Au cabinet, je compte le nombre de masques en réserve. Je dois avoir 200 masques chirurgicaux et quelques FFP2 datant de la grippe H1N1 de 2009. Pas beaucoup de réserve de désinfectants. C’est un peu juste. Le 9 février, un dimanche matin, j’entends à la radio que tu as infecté cinq Britanniques en Haute-Savoie dans un chalet des Contamines-Montjoie. Là tu mets un nouveau petit coup de pression. Tu as déjà tué 900 personnes en Chine. Je mets encore ça en perspective avec les 100.000 morts possibles chaque année de la grippe dans ce pays. Ce n’est rien du tout. Mais je me dis aussi qu’il faut être dans l’anticipation. Cela ne coûte rien de refaire mes stocks maintenant. Je m’installe devant mon ordinateur et je commande gel, alcool, savon et masques. Tiens, les masques ne sont déjà plus disponibles. D’autres collègues doivent avoir la même idée.
Le lendemain, je suis à nouveau à mon cabinet comme un lundi matin. Je suis là à regarder la salle d’attente colorée, les jeux pour enfants, le présentoir des brochures, la petite table à journaux. J’hésite. Je me demande ce que je dois faire. Commencer à m’adapter ? Ne pas contribuer à la psychose qui monte ? Finalement, j’enlève, triste, les revues et les tapis de jeu. Je verrai bien comment les choses évoluent. Dans la matinée, un petit garçon demande à son père : « Mais ils sont partis où les jeux ? » Son père lui répond : « Ils sont en vacances peut-être, ils vont revenir. » Ni lui ni moi ne souhaitons faire de commentaires. L’anxiété prend place un peu plus. Au fil de la semaine, je vois et revois dans ma tête les stratégies suivantes à mettre en place, pour organiser la distanciation et la prévention des contaminations. Je me dis que le port du masque va être une étape difficile, qui va acter devant les patients que pour moi le risque est là. Le 25 février, un enseignant d’un collège de Crépy-en-Valois dans l’Oise est le premier Français à décéder. Tu as été retrouvé dans son corps à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Cet événement fait encore monter d’un cran la pression. Je me décide à mettre un masque chirurgical autour du cou que j’applique sur le nez seulement le temps de l’examen clinique. J’enlève les quelques brochures qui restent à toucher en salle d’attente. Je transporte la petite table à revues dans la salle de soin. Je la positionne devant mon bureau pour accentuer la distance avec les malades. Je place à côté du clavier de mon ordinateur et des lecteurs de cartes verte et bleue, du coton et une pissette d’alcool à 70% pour désinfecter des trucs où tu pourrais te poser. J’ai pas mal de réserve en gel hydroalcoolique, mais il me manque un flacon de petite taille à mettre là sur mon bureau à portée de main. Je me décide à aller en acheter en début d’après-midi dans une pharmacie. Je visite les cinq officines du quartier. Plus rien : ni gel, ni masque. Les pharmaciens me disent que c’est la panique, qu’ils passent leur temps à voir des personnes qui en cherchent et qu’ils n’ont plus rien.
Je retourne à mon cabinet vers 15 heures. Pris dans ce mouvement, je mets en place mon masque, mais cette fois sur le nez avant de faire rentrer la première patiente de l’après-midi. Je vais tester le dispositif de distanciation : je l’invite à rentrer dans la salle de soin. Elle me fait un triste sourire à la vue de mon visage caché. Je lui montre la chaise derrière la petite table, elle-même derrière la grande table de mon bureau. Elle s’assied là à plus d’un mètre de moi, et moi je suis face à elle avec mon masque sur le nez. Elle semble tétanisée. Elle arrive à lâcher : « ça fait peur ». Moi je suis si triste, touché par la sensation d’être ridicule, et par cette distance que j’installe, quand mon cabinet était un lieu de convivialité, de proximité, d’humanité.
Voilà ce que tu sembles instaurer cher Coronavirus : la distance. Plus tu t’es installé sur notre territoire, et plus les choses se sont accentuées. Ce sentiment de honte à trop en faire s’est assez vite estompé au fur et à mesure que tu tuais les personnes. Je me suis mis à travailler en permanence avec mon masque. J’ai changé le mobilier de ma salle de soin, enlevé les paravents, déplacé les chaises. Tout est fait pour que les personnes ne te déposent nulle part. J’ai rajouté un petit écriteau sur la petite table devant mon bureau : « Le but du jeu est de ne pas toucher cette petite table 😉 ». Le smiley, c’est pour adoucir… J’ai scotché sur la poignée de la porte de la rue « Poussez avec le coude ». J’ai mis des affichettes en salle d’attente « Si vous avez de la fièvre ou si vous toussez, signalez-le-moi et je vous donnerai un masque ». Tout est en place. Les personnes ne touchent presque plus rien dans le cabinet sans mon autorisation. Tu as radicalement changé ce lieu : il est devenu celui du risque et de la distance. Au fur et à mesure que tu infectais, les gens avaient de plus en plus peur de venir me voir. Je voyais des mines craintives, des gestes hésitants, certains étaient masqués, gantés, les mains presque en l’air pour ne rien toucher. À moitié burlesque ! Devant le risque sanitaire représenté et la baisse de fréquentation à mon cabinet, j’ai dû me mettre la mort dans l’âme à la téléconsultation. J’ai adapté et réglé dans la précipitation mon matériel informatique et mon agenda électronique. Et j’ai fait mes premières consultations à distance. Je n’aime vraiment pas ça, cette médecine au rabais. Quand le télé-médecin a de l’autre côté des écrans, des outils connectés avec, encore mieux, une infirmière qui les manie sur le patient, c’est peut-être pas mal. Mais là, rien. Juste une visio et un dispositif de paiement. Et les gens s’y font très vite. Je les vois apparaître ou je leur parle au téléphone comme le dispositif ne fonctionne pas une fois sur deux. Ils me disent : « Docteur, j’ai mal au ventre. » Certains m’envoient des mails : « Docteur, mon père a mal dans une jambe depuis sept jours, merci de m’envoyer l’ordonnance d’un médicament. » Des collègues médecins avancent qu’il faut soigner un maximum comme ça, éviter le plus possible aussi de se déplacer chez les patients Covid, sinon il faut s’y rendre équipé de masques FFP2, lunettes, blouses, charlottes, surchaussures, comme à la télé. Tu sembles opérer une mutation radicale du lien avec mes patients. Le changement est si subi et total que je me demande si un retour en arrière sera possible. Est-ce cela ta triste république, Coronavirus ?
Et puis, j’ai fait ta rencontre. Le lundi 9 mars, je soigne un patient qui présente un état grippal qui dure depuis plus d’une semaine, associé à de fortes sueurs. Le tableau est très atypique. Je pense que c’est toi qui es là. Le lendemain, je vais en visite à domicile chez une jeune femme de trente ans qui présente les mêmes symptômes. Chez elle, je me passe du gel hydroalcoolique sans cesse. Je vois combien ma stratégie pour me prémunir de toi n’est pas assurée. Mes gestes sont trop hésitants et je dois travailler davantage les automatismes. Et puis les patients se succèdent, pas beaucoup, pas de vague, mais un ou deux tous les jours où je me dis que c’est peut-être toi. Mais les tests ne sont pas disponibles. Je ne peux être sûr. Et j’ai du mal à changer ma pratique. Pourquoi faire différemment avec toi, virus ? Justifies-tu vraiment de renoncer à discuter de vive voix, à examiner, palper les ventres, voir les gorges, écouter les poumons et les cœurs ? Je sens que tu te rapproches toujours un peu plus. Je suis là juste à ta portée. La famille C. que je connais de longue date semble touchée à son tour. Les deux parents sont malades et deux des enfants aussi. Avant, on parlait souvent de toi avec Marcel, le père. Je l’aime bien. Il te prenait très au sérieux lui. Il avait très peur de toi. L’autre jour, il faisait les courses dans un supermarché. Il a vu une femme faire un malaise. Il a posé son sac à provisions au milieu du magasin et est parti en courant. On a bien rigolé quand il m’a raconté ça. Il pense que c’est Dieu qui t’envoie, que ta venue était prédite dans la Bible. En une semaine, Marcel s’est mis à aller de plus en plus mal. Pas de fièvre, un peu de toux, une douleur oppressive dans la poitrine et surtout une sensation de manquer d’air, d’avoir du mal à respirer. Toujours pas de tests. La saturation que je mesure avec un petit appareil sur le doigt du malade montre un taux d’oxygène du sang qui descend lentement mais sûrement au fil des jours. C’est toi là, j’en suis sûr. Je n’ai jamais vu un tel tableau. J’organise le passage quotidien chez lui d’un collectif d’infirmiers qui se relaient pour aller chez les malades équipés en cosmonautes. Ils ont récupéré, m’ont-ils dit, des combinaisons de carrossiers. Après deux jours, un des infirmiers me téléphone et nous appelons le SAMU pour venir chercher le pauvre Marcel. Tu sapes sa respiration. Il dit qu’il étouffe. Il ne dort plus. Il ne mange plus. Le lendemain de son hospitalisation, sa femme m’appelle. Lumina, sa fille aînée de 20 ans, enceinte de cinq mois, respire difficilement à son tour. La famille parle mal le français. C’est la panique à la maison. Je leur dis que je passe en début d’après-midi. À ce moment de l’épidémie, la crainte sur ta dangerosité est maximale. Le nombre de morts en France croît chaque jour. Je comprends que mes comparaisons avec la grippe ne sont peut-être pas les bonnes. Le mode de transmission laisse aussi une place à l’incertain. Je me dis que ce passage à domicile est très à risque pour moi. La famille habite à sept dans un petit appartement. Même si les plus jeunes enfants n’ont pas de symptômes, tu les as sûrement infectés aussi. Je repense aux consignes de téléconsultation, aux recommandations de s’équiper en cosmonaute. Le sanitairement correct. Je vais juste mettre comme avec les autres patients Covid un masque FFP2 et des lunettes de protection. J’ai là la conviction qu’il faut faire cette visite, il faut être là avec cette famille qui vit une tragédie, peut-être même pensent-ils, une damnation. Une fois chez eux, j’examine Lumina, sa saturation baisse comme celle de son père. Là tu m’impressionnes. C’est la première et unique fois où je te prends très au sérieux. La future maman passera les quatre jours d’après en soins intensifs. En fin de visite, Madame C. me passe son mari au téléphone qui me dit avec difficulté de son lit d’hôpital que ça ne va pas, que les médecins vont le faire dormir pendant trois semaines, qu’il a peur. Il sera curarisé et intubé en réanimation l’après-midi même. Je suis là dans cette famille que tu as infectée. Je te vois à l’œuvre. Tu menaces la vie de deux des quatre malades. La mort est là dans cette histoire. Je me vois faire le choix en conscience du risque de rejeter téléconsultations, blouses, charlottes et surchaussures. Il faut que je sois là. Ce n’est pas qu’une obligation déontologique ou la crainte de la non-assistance. C’est juste que c’est important pour ma vie autant que pour leur vie, de tenir ma place. Ce moment est si dense, si total, que savoir que je ne l’ai pas vécu aurait par la suite manqué lourdement. Il me semble impératif d’accepter que tu puisses m’infecter pour pouvoir vivre entièrement, exister complètement.
Cher Coronavirus, tu me fais penser là à ces amants qui font l’amour la première fois sans le latex consensuel. Je les vois parfois venir en consultation quelque temps après, un peu ennuyés à me demander un test de dépistage pour, ce que l’on appelle dans les cabinets, un rapport non protégé. En tant que professionnel de santé, je peux les interroger : comment se fait-il qu’ils ignorent encore les risques encourus, ceux de se faire infecter par tes collègues, VIH, hépatite B et autres bestioles. Je peux me dire qu’ils ne maîtrisent pas leurs désirs et qu’ils se laissent trop facilement emporter. Mais pourquoi ceux-là n’auraient-ils pas fait un choix, le choix de vivre pleinement et sans interruption ce moment dont ils rêvent peut-être depuis des semaines, ce moment dont le souvenir sera un plaisir refuge dans leur vie, ce moment important qui, pour qu’il soit entier, demande à prendre le risque de l’autre. La santé peut être le bien que l’on envie, mais n’est pas la valeur suprême, dit Montaigne.
Cher Coronavirus, je veux te remercier. Elle est là en fait la république que tu fondes. Tu mets au débat qu’à mesure que la distanciation sociale se crée, l’existence se rétrécit d’autant. À mesure que l’on tente d’éviter la mort, la vie se rabougrit. Je me rappellerai longtemps cette sensation d’un bien-être profond en sortant de chez la famille C, en ce jour si terrible pour eux. Je rentrais à pied au cabinet. Il faisait beau, presque chaud. Je partais de là peut-être infecté de toi. Certes, temporisons l’héroïsme, tu n’as pas la carrure d’Ebola et bien celle d’une sale grippe, mais la mort était bien pour moi une des issues possibles. Je me suis mis en situation le temps du trajet, de ce que je dirai à ma famille avant de partir à l’hôpital : que l’amour que nous nous portons avant ce jour sera le même après, quoi qu’il m’arrive. Je me suis mis en situation de ce que je voudrais vivre dans mes possibles derniers instants de conscience, juste avant la perfusion qui m’endormira pour laisser le passage à la sonde d’intubation : plonger mon regard dans celui de l’infirmière pour profiter encore, intensément, et peut-être pour la dernière fois, de cette humanité chérie. Tu me montres, cher Coronavirus, que cette pensée de la mort donne le précieux à chaque instant de la vie. Tu me dis que ne pas mourir n’est pas un but suffisant pour nos existences. Prendre le risque de l’Autre pour vivre complètement.
Lucas M.