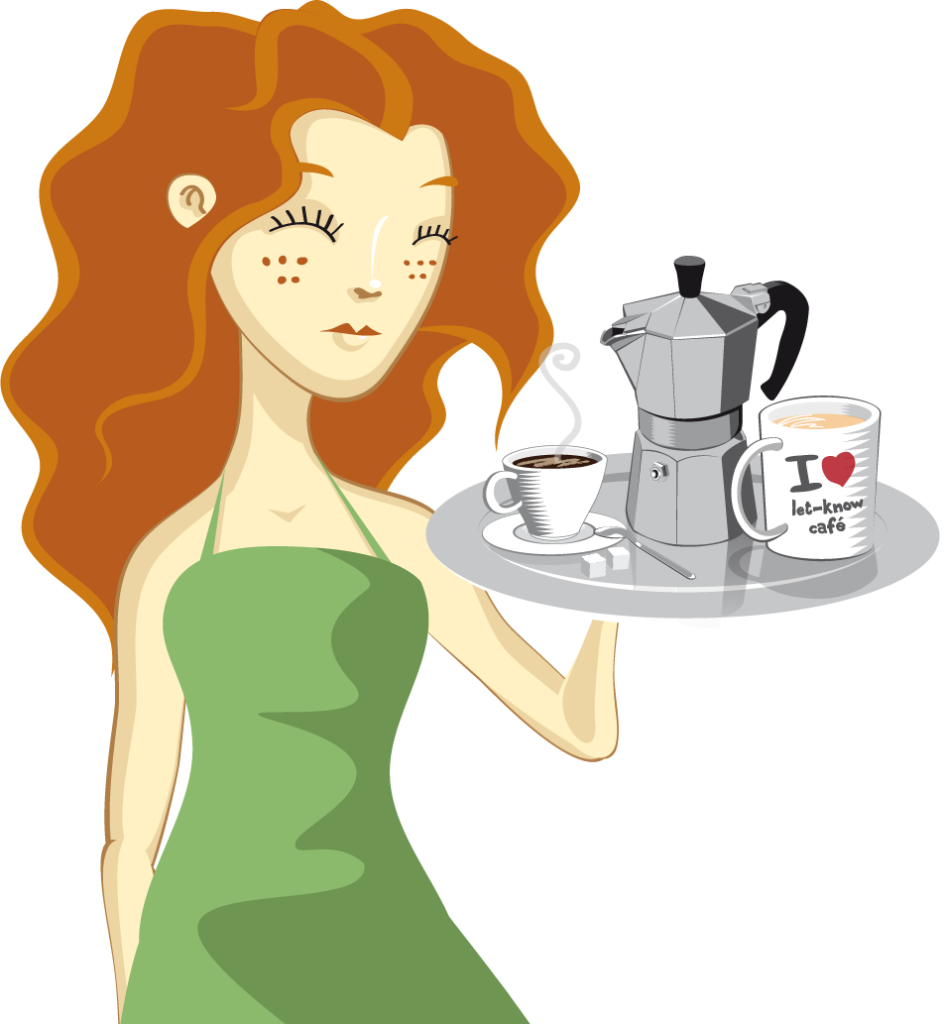Prendre un café et savoir mourir (audio)
Emmanuel Lafaye et Jean Faya
10 septembre 2016
Emmanuel Lafaye est infirmier psy hors les murs.
Je connais Emmanuel Lafaye de longue date. Il est infirmier en psychiatrie. Il a travaillé de nombreuses années auprès d’un public à la rue et très marginalisé. Je lui ai proposé de se donner un temps ensemble pour qu’il me raconte son travail si singulier, et que nous écrivions une poétique. Nous sommes au mois de juin 2016. Nous nous installons ainsi autour d’une table dehors, dans un petit jardin. Quelques oiseaux chantent. Le soleil commence pour la première fois de l’année à sérieusement chauffer l’environnement. Je sors mon dictaphone. Je le mets en marche.
« Comment veux-tu que nous fassions ? » me dit Manu. « Tu veux me poser des questions, je te raconte une histoire ? D’accord pour l’histoire. Il y en a une qui me semble riche, celle de Thierry. »
La rencontre
La première fois que j’ai rencontré Thierry, on maraudait avec des collègues du Samu social. Il faisait partie de la tournée ce jour-là. Des voisins avaient probablement alerté les services sociaux de la présence de cette personne qui squattait en bas de chez eux, sans domicile fixe. Thierry s’était trouvé un coin dans un immeuble au niveau des quais de Saône, en face de Perrache, dans une allée, sous un escalier, à la croisée d’un couloir et d’un parking à vélos. Il était là, à l’abri de l’eau et dans les courants d’air. Les escaliers partaient en virage, et du coup, ce qui était impressionnant, c’est qu’il était complètement dans le noir. La première fois, je ne l’ai même pas vu. J’arrivais de la lumière et je ne voyais rien. J’ai juste entendu une voix au fond de ce trou noir, dans une ambiance souterraine, comme si elle venait d’une crypte. Les collègues du Samu le connaissaient. Ils faisaient attention. C’était là un bout de chez lui, même s’il s’agissait d’un squat au milieu du passage. « Est-ce qu’il y a quelqu’un ? On est du Samu social. Est-ce qu’il y a besoin de quelque chose ? » Ce jour-là il n’a presque pas répondu. Et puis finalement il a lancé : « Non ça va, c’est bon. » Il ne voulait rien. Il gardait la distance. « Ok d’accord, on repassera » a-t-on répondu. Et on est repartis.
Et voilà. À cette époque-là, Thierry fréquentait régulièrement une association d’accueil, et quelques lieux comme ça, où il avait malgré tout de bons liens. Je l’ai recroisé un an ou deux après. Il avait pu accéder à un logement grâce à tout le travail du Samu social. Il vivait dans un CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale). Il y bénéficiait d’un étayage avec un éducateur qui l’accompagnait sur le quotidien et une assistante sociale qui avait pu le remettre à flot sur les prises en charge genre RMI, puis RSA. Le Samu social avait demandé à une collègue de la structure où je travaillais, si elle pouvait l’accompagner. Thierry allait sans doute avoir aussi besoin d’un étayage en psy. Et assez rapidement, ma collègue a changé de travail, et m’a passé le relais. Et dès lors, j’ai vu Thierry pendant six ou sept ans, une fois par semaine. On prenait le café.
Il avait un côté attachant ce Thierry. Ce n’était pas le gros psychopathe agressif qui fait chier. Non, lui, il n’est pas là-dedans. C’était un homme de la quarantaine au regard absent, ou en tout cas très vite fuyant. À l’époque de notre première rencontre, il n’était pas capable de regarder dans les yeux. Il était maigre, les cheveux complétement décoiffés, mis en arrière, très fins, des cheveux qui font un peu malade, secs et ternes, comme les gens qui sont malnutris. Il avait bénéficié de soins dentaires, avec du coup, des couronnes partout. Il présentait ainsi des ratiches toutes blanches, nickel. Il avait grandi à Annecy, avec probablement une histoire bien compliquée quand il était gamin. Il avait réussi à bosser dans les espaces verts à une époque. Il avait même eu une copine pendant un temps quand il était sur Grenoble. Mais il était déjà en situation de marginalité et d’exclusion.
Le début des cafés
Pendant longtemps, je venais le chercher chez lui, et je montais jusqu’à la porte de son appartement au premier étage. Je sonnais. J’attendais qu’il se prépare et on redescendait. Le rituel de nos rencontres a mis du temps à se définir. Au départ, on ne choisissait pas toujours le même lieu. Au bout d’un an, on avait nos habitudes installées. Je sonnais à sa porte et j’attendais désormais en bas. On se disait bonjour. Il acceptait de venir prendre le café. C’est vrai qu’il y avait quelque chose presque de l’ordre du protocole, notamment dans notre façon de nous saluer ou de parler. Et Thierry était toujours au rendez-vous. Avec d’autres personnes, on travaillait l’idée de cultiver le manque. On était là, mais les personnes ne saisissaient pas l’occasion de la rencontre. Et Thierry non, la question de l’absence, il ne me l’a pas fait vivre plus que ça. Je n’en ai en tout cas pas le souvenir. Sur sept ans, il y a eu peut-être deux ou trois loupés… On allait toujours dans le même PMU à deux cent mètres de chez lui. On faisait notre temps d’entretien. Cela pouvait durer dix minutes, un quart d’heure, et à la fin plus longtemps, une demi-heure (rire).
Au début, il ne parlait pas beaucoup. Très rapidement, il y a plein de trucs qui se jouaient. Par exemple, on payait le café chacun à notre tour. Et là, j’ai en tête du Marcel Mauss, et les questions du don et du contre-don, qui font que si on t’offre quelque chose et que tu ne rends pas en retour, il se crée une situation de conflit… Mais cela s’est fait sur le moment assez naturellement et c’est après que j’ai pu repenser tout ça. Sur ces temps-là, on était ensemble. Et les premiers souvenirs que j’ai, c’est que l’on était en terrasse et rien… Il ne se passait rien… Et moi je lançais : « Vous avez fait quoi ? Vous avez regardé la télé ? Comment ça va ? » À des moments, je le sentais complètement envahi. Il entendait des choses, sûrement des hallucinations, peut-être visuelles, à voir son regard… Au bout d’un temps, on arrivait à parler du tiercé qui passait à la télé, ou des choses extérieures, de l’actualité. On a même fait de la pétanque, mais toujours dans le cadre du PMU où il y avait parfois des boules à disposition… On appelle ça des outils de médiation. Quand on prend un café, on tape les boules, ce sont des choses qui nous permettent de faire le lien avec la personne. Quand on mène ces simples activités, il y a de l’humain qui se fait autour.
Après quelques années, il parlait davantage. Il avait même des automatismes. Il avait en tête les questions que je lui posais d’habitude, notamment au sujet de son boulot. Il avait recommencé à travailler dans les espaces verts, puis dans des ateliers adaptés de tris de pièces mécaniques, et enfin, de nouveau aux espaces verts. C’est ce qui lui plaisait. Nous échangions sur comment faire le casse-croûte pour aller au boulot, sur les repas partagés sur les lieux de vie, sur comment s’habiller quand il fait froid le matin, sur des petits points de repères qui étaient importants pour lui et qu’il évoquait. Il y avait probablement aussi plein de choses qu’il me cachait. Parfois, j’avais l’impression qu’il venait prendre des mots à moi pour se les approprier. Il y avait aussi du mimétisme par rapport aux vêtements. Étonnamment, dès qu’il a commencé à avoir un peu de sous, il aimait bien acheter des marques, notamment les marques de montagne. À une période, je portais ce genre d’habit et il a alors trouvé quasiment le même. Pareil au niveau des lunettes. Il y avait des jeux très projectifs de sa part où il avait besoin de s’approprier des choses de mon image.
Au cours de l’entretien, la même question revenait toujours. À quel moment on s’arrête ? À quel moment ce face-à-face devient difficile pour lui ? Et moi, pendant cette demi-heure où je prenais le café avec lui, j’avais aussi des éprouvés très particuliers, parce que Thierry me faisait vivre ce que lui vivait de ses angoisses. Et j’étais là avec lui, et avec le temps de me poser plein de questions : qu’est-ce que je fais là ? À quoi ça sert, si ce n’est de me dire en fin d’entretien : qu’est-ce que l’on fait ? Quand faut-il sentir que, voilà, là, c’est fini ? Mais en même temps dans notre rituel, la fin était devenu quelque chose que l’on savait repérer. « On se recale un rendez-vous ? » Et chaque semaine, on se recalait un rendez-vous. On avait fait le tour des questions que l’on aborde habituellement.
Vers le soin
Régulièrement j’essayais de l’amener vers le soin, en sentant que c’était hyper sensible. J’avais l’impression que si j’avançais de façon trop frontale, cela allait lâcher entre nous. Je sentais que le lien qui se tissait, il fallait qu’il se tisse dans le temps, et que tout le travail autour de ce café était un travail où l’on s’apprivoisait mutuellement, où l’on apprenait à ne pas se faire peur. À un moment, ses belles ratiches se sont mises à tomber. Et moi, en tant qu’infirmier psy, je n’étais pas plus à l’aise que ça, à aborder les questions de santé somatique. Je n’osais pas trop y aller. Je lui disais, « Oui, ce sera bien de retourner chez le dentiste… » Il disait « ouais, ouais, je vais prendre rendez-vous. Mais de toute façon, mes dents, elles vont repousser. » Il pouvait parfois tenir des propos comme ça avec des éléments un peu délirants. C’était du coup difficile d’avancer sur le concret avec lui. Il mettait tout à distance. « Non, non, c’est bon, je vais m’en occuper. » Je n’avais pas beaucoup de prise sur ces choses. Il était capable de créer un gros flou. Et pour lui, il devait être important de construire cette zone-là. Il ne voulait pas non plus aborder la question de sa consommation d’alcool, dans laquelle il se faisait entraîner par d’autres personnes sur son lieu de vie. Idem pour le cannabis, qu’il consommait, je pense, régulièrement. Il revenait parfois avec des gros coquards. Je lui demandais ce qu’il lui était arrivé. « Non, rien, je suis tombé. » J’essayais d’amener des choses pour qu’il puisse en parler. Il y avait sans doute, comme souvent sur la consommation de stupéfiants, quelque chose de la peur du jugement. Si j’avais commencé à lui parler de shit, je pense qu’à ce moment-là je l’aurais perdu. Mais c’est peut-être moi qui avais du mal à aborder ces sujets. Au début, il fallait sans doute respecter cette distance, mais c’est aussi la difficulté. Une fois que tu as commencé à être dans un lien, changer de position, ce n’est pas simple.
Au fur et à mesure que le temps avançait, je me disais qu’à un moment donné, il faudrait que s’arrête ce truc, cette régularité, d’autant que lui, il avançait quand même dans son trajet de réinsertion. Il a pu changer de logement. Le CHRS où il était, est un hébergement avec des baux de six mois et des éducateurs qui sont là pour que les personnes se réinsèrent dans le monde du travail. Mais beaucoup sont en fait, accompagnés sur ces lieux-là pendant des années. Et ils ont toujours cette épée de Damoclès qui les menace, d’être un jour obligés de partir, notamment si on estime qu’ils n’ont pas fait assez d’efforts pour se réinsérer. Thierry a quitté cet endroit pour une maison relais. La maison relais, c’est un bail classique. Tu es locataire. Il y a un salarié dans la structure qui est présent. Il est là pour réguler les choses avec des temps collectifs, des repas avec les autres résidents de la structure. Il y a donc un petit accompagnement qui fait que si le loyer n’est pas payé, on peut interpeller la personne, reprendre contact avec l’assistante sociale. Après avoir intégré ce lieu, Thierry a pu à nouveau accéder au travail, un travail adapté.
L’air de rien, j’ai pu lui glisser à un moment qu’il y avait un toubib dans mon équipe, et que ce serait sympa si on pouvait prendre le café ensemble. Et ainsi, j’ai réussi à introduire Paul, mon collègue médecin, dans l’histoire du café. On s’est rencontré un jour tous les trois. Et comme c’était un docteur, non seulement il payait le café mais en plus les croissants ! Paul l’a vu de cette façon, une à deux fois par an. Et même lui, avec toute son expérience, il disait qu’il ne savait pas bien ce qui se passait dans ces temps-là. Il y avait effectivement quelque chose qui se tricotait, mais on ne savait pas bien quoi. Paul a pu dire à Thierry qu’il avait le droit à l’AAH (Allocation Adulte Handicapé), que la question de travailler restait pour lui difficile. Et tout doucement, Thierry a pu accepter l’idée du handicap, la question du retour au travail adapté, de choses comme ça, en mettant toujours à distance la relation de soins conventionnels type neuroleptiques. On pouvait faire le constat que le lien, le temps du café et ce qui se jouait autour, le temps de médiation, c’était aussi un super neuroleptique. Et que Thierry, ben il allait beaucoup mieux juste parce que l’on avait des temps où les choses se posaient pour lui. Il avait des points de repères, et des pans de son existence ont pu sans doute aussi se structurer à cause de ces moments. Et je pense encore que le travail qu’il a finalement trouvé, a dû l’aider énormément. Il y a pas mal de choses comme ça qui ont pu se tricoter, et avancer (silence)…
Se dire au revoir
Et en fait, j’ai peut-être voulu te parler de Thierry, car l’histoire, je n’ai pas pu la finir moi-même. C’est parce que moi je partais, que l’histoire s’est arrêtée (silence). On en avait quand même parlé en analyse de la pratique. C’était il y a un an. Et la conclusion, c’est qu’à un moment donné, il faut savoir se dire au revoir. Et que quand la personne va mieux, il faut savoir lâcher un lien, pour qu’elle puisse investir d’autres lieux de soins. Et donc, j’ai vécu cette difficulté de pouvoir dire au revoir, de pouvoir lâcher la situation, et de dire ma position de soignant. Ben oui, ok, Thierry, ce n’était pas un pote avec qui j’allais boire un café. C’était quelqu’un qui m’investissait moi, en tant qu’infirmier, même s’il y a des moments où on ne se rappelait plus que moi je venais parce que j’étais infirmier et que lui, il venait parce que c’était un temps important pour lui. Cette dimension fut toujours présente. Au fil du temps, on s’était installé dans la situation. Qu’est-ce qui fait qu’à un moment, on arrête ce suivi ? Quand j’ai eu à lui annoncer que je partais en janvier, j’avais en tête qu’à un moment j’aurais à lui dire au revoir. Et étonnamment, à chaque fois que j’aurais pu le faire, il y avait un truc qui empêchait, du genre des soins dentaires à mettre en place, caler le renouvellement du RSA, de telle allocation, ou tout autre chose. Cela amusait beaucoup la collègue du lieu d’hébergement. Elle rigolait. Elle se foutait de moi. Et elle avait raison…(silence). J’avais cette idée que si moi je partais, il allait à nouveau se casser la figure. Comment je pouvais remplacer le café ? Qui pourrait prendre le café avec lui à ma place ? Ça, c’est un des gros problèmes des psys, de croire qu’à un moment donné, ils sont irremplaçables. Quand tu es en lien avec une personne, il y a la problématique de se dire que les autres ne feront pas aussi bien que toi. Mais j’ai fini quand même par lui dire que j’allais arrêter de le voir, que moi je pensais que c’était important ces temps de café, que c’était un moment important pour lui, qu’il y avait d’autres endroits où cela pouvait se faire. Je lui ai dit qu’il fallait qu’il prenne rendez-vous dans un CMP (Centre Médico-Psychologique). Au début, c’est évident, il aurait refusé de façon massive, le lien n’étant pas là. Il n’aurait pas pu accrocher sur du lien conventionnel. Et là, étonnamment, il a accepté. Et le dernier jour que j’ai passé dans la structure de l’époque, j’ai accompagné Thierry à son premier rendez-vous au centre. Étaient présents aussi la responsable de son lieu de vie, et le responsable de son travail. Tout le monde avait peur que ça lâche, que des trucs ne tiennent pas… Nous avons pu tous ensemble discuter avec un des psychiatres qui allait le pendre en charge. Et je suis resté après le rendez-vous un petit moment à échanger avec ce médecin, à nous questionner. Moi, je sentais bien que c’était un bout de moi que je quittais avec un sentiment de culpabilité, d’abandon. Et en même temps, en tant que professionnel, t’es pas censé être là-dedans. Ce n’est pas ton patient. Il ne t’appartient pas. J’essayais de rationaliser, mais dans mon vécu intérieur, il y avait aussi ça qui était présent. Et donc on s’est dit au revoir avec Thierry, qui partait, qui avait fixé un prochain rendez-vous avec le psychiatre, et où dans cet endroit, sans doute, un relais a été possible. Après, comment ça a accroché entre eux ? Comment il a investi la relation ? Je me le demande. Il reste cette idée que Thierry aura toujours besoin de petits accrochages comme ça sur des temps, pour que sa parole puisse se poser.
Les vraies questions.
Sur cette histoire, il y a vraiment un truc autour duquel il faut poéter ! Moi, je suis persuadé que voir Thierry une fois par semaine a été super important pour lui. Mais je n’ai aucune mesure de ce qui a pu se construire. Le constat, c’est qu’avec le temps, l’angoisse a largement diminué. Il y a là des vraies questions. On n’est pas dans du soin psy balisé. Et quand on soigne, il faut croire en ce que l’on fait. Oui, c’est de l’ordre de la croyance. À un moment donné, j’étais là sans cadre clair. Alors, je me raccrochais au seul truc auquel je crois : on est des êtres de paroles, et la parole permet à l’autre d’exister dans le lien. La parole est aussi une façon d’entrer en contact avec l’autre et de lui permettre d’exister en tant qu’être humain. Ça, c’est le soin. Et installer ça dans la régularité, dans cette idée de faire exister Thierry en tant qu’être humain, et ben ça, c’est du soin. Et c’est le seul truc que j’avais comme point de repère. J’ai accompagné beaucoup de personnes dans mon travail. Souvent je pense à certains d’entre eux et c’est le mot « naufragés » qui me vient, comme le titre du livre de Declerk. Je trouve que ce titre est joli… La vie de ces gens n’est souvent que tempête et tornade. Ils surflottent à peine et toi tu essaies de les ramener. Et malheureusement tu vois aussi les bateaux couler. Et tu peux rien faire car il n’y a rien à faire. Et il y en a quelques-uns comme ça, que tu arrives à ramener sur la terre ferme, à se réparer, à tenir un peu debout…
Et de mon côté, moi parfois j’étais angoissé, ou plutôt, c’est Thierry qui me faisait vivre ses angoisses. À un moment donné, je me suis sans doute mis à disposition pour partager ce que lui vivait. Et il y avait sans doute à ce moment-là une forme d’irréalité, dans ces instants où tu es dans le lieu et tu vois les choses. Et elles, elles prennent une autre forme. Tu te dis : est-ce là le réel ou n’est-ce pas là le réel ? Par exemple, on est assis à la terrasse. Il y a des moments de silence et moi je suis là. Et lui, il est là. Et je sens à côté de lui qu’il y a des moments où il n’était pas tout seul. Il était avec son angoisse. Et moi, l’impression que j’avais, c’est que si par exemple il y avait une voiture garée devant, je pouvais regarder le feu de la voiture jusqu’à me questionner : est-ce que ce feu existe vraiment ou pas ? Il m’emmenait dans un mode de réflexion qui n’était pas mon mode habituel, et qui était un peu inquiétant. Cela me fait penser au chamane qui est dans un état modifié de conscience, et où à un instant donné, il regarde une fleur et à travers la fleur, il voit autre chose. Il y avait sans doute un peu de ça qui se jouait dans ces moments-là. Il y a cette idée que dans le développement de la construction du langage, au tout début, avant que l’on assimile les mots et la symbolisation, le nouveau-né est en symbiose avec sa mère et n’a pas vraiment conscience qu’il est un individu en propre. Et à partir du huitième mois, l’enfant comprend l’existence d’autres personnes que sa mère. Et dans les réponses qui lui sont faites, il comprend que ce n’est pas parce qu’il pleure qu’il est satisfait au niveau de l’alimentation, mais qu’il y a d’autres choses qui se jouent et qu’il y a un autre qui existe là. Et du coup, il va pourvoir construire des échanges verbaux. Et donc, en théorie, on a tous connu ce que l’on appelle la psychose, c’est-à-dire le moment où la définition de nos limites propres n’est pas complètement construite. Et à trois ans, c’est acquis qu’il y a moi et les autres, avec des interactions entre chacun. À mon sens, certaines personnes psychotiques n’ont pas réussi ce cap-là. Elles n’ont pas assimilé très clairement le fait que leur pensée propre existe. Mon fils me demandait hier, c’est quoi ton travail ? J’essayais de lui expliquer ce qu’est le délire, l’hallucination et ce qui fait qu’à un moment donné, une personne entend des voix. J’aimerais faire une recherche sur toutes les lectures possibles autour de ces voix. Le chamane pour beaucoup en occident, ne serait qu’un gros psychotique avec des hallucinations auditives et visuelles, et rien d’autre. L’idée de la pensée occidentale et psychanalytique, c’est que quand moi je pense et que je construis une histoire dans ma tête, je sais que c’est moi qui construis cette histoire. Et certains psychotiques ont du mal à faire la différence entre ce qu’ils construisent dans leurs têtes et de ce qui existe vraiment à l’extérieur. La frontière n’est pas claire. Je pense que Thierry à ce moment-là, m’a fait revivre des choses que j’avais vécues quand j’étais tout petit. Oui, encore une fois, je pense que la psychose, on l’a tous traversée. Et quand on a quelqu’un qui est encore dedans, et bien, il peut nous faire vibrer à ces endroits-là. Sans doute les chamanes et les gens comme ça, ont cette capacité à aller toucher cette dimension-là qui leur permet d’accéder à des sensibilités que nous n’avons plus. On est trop dans le contrôle de plein de choses.
Oui, j’aimais bien ces temps-là. Pas le café… Il était un peu dégueu… Mais oui, je crois qu’il y a eu un attachement avec Thierry, tout simplement. Le fait de le retrouver, de me dire que là, par le boulot que j’ai fait, il y a quelque chose qui a pu se construire. Quelqu’un a pu réussir à avancer. Il y a souvent dans ce travail des gens hyper attaquants dans le lien, dans des processus tellement autodestructifs que oui, on regarde les bateaux couler. Et là dans cette histoire, il y a quelque chose qui devait me permettre de me dire que ce que je fais n’est pas complètement à côté de la plaque. Thierry était quelqu’un d’agréable. Bon, je ne dis pas que je partirais en vacances avec lui. Mais ce qui faisait que c’était possible, c’est justement que c’était sur le temps de travail, que j’étais payé pour faire ça. C’était sur un temps défini. Si je n’avais pas changé de travail, j’aurais arrêté la prise en charge, enfin je l’espère. J’espère que je ne suis pas aussi mauvais que ça. En tant que soignant, en tout cas, au niveau du soin psy, si tu considères que l’autre existe vraiment, à un moment donné, il faut accepter qu’il puisse vivre sans toi. Il faut pouvoir le penser même si au début, ce n’est pas possible. Il y a là quelque chose de l’ordre d’accepter de mourir, c’est-à-dire que tu disparaisses de sa vie. Il y a une forme de mort de la place que tu as pu occuper avec lui, et de dire, ouais, je ne suis pas indispensable. De toute façon, il va continuer sa vie autrement. Cela me fait penser à ce film « Gravity », avec George Clooney. Les héros de cette histoire, un homme et une femme, sont en détresse dans des stations orbitales autour de la terre. Ils essaient de se raccrocher aux différents modules spatiaux et à chaque fois, ça foire. On en avait parlé en analyse de la pratique, avec un psy assez brillant, qui disait que Clooney, dans ce film, il occupe la place du thérapeute. Dans cette aventure, son personnage est attaché de façon physique à sa partenaire. Ils sont tous deux en scaphandre dans l’espace, et il décide de se détacher, seule solution pour qu’elle au moins survive. Et il est alors emporté dans l’espace. Elle se retrouve toute seule, et elle arrivera à s’en sortir. Et notre analyste disait : dans les faits, dans une thérapie, il faut à un moment donné que le psy meurt, pour que la personne puisse se réapproprier les choses, et exister par elle-même. Donc là, je suis parti dans l’espace. J’ai fait mon George Clooney. Et j’espère que Thierry avec son module spatial, il va réussir à retourner sur terre et trouver un peu de tranquillité. Dans le film, le module arrive sur la planète bleue, mais pas de bol, il tombe dans un petit lac. Et il faut que même sur terre, elle lutte pour ne pas mourir noyée. Il faut qu’elle sorte de l’eau. Et ça fait aussi penser à une espèce de renaissance. Tu te libères du liquide amniotique et tu pousses ton premier cri ! (rires). Oui, il est beau ce film. On voit cette femme qui se tient debout, là au bord de l’eau. On a l’impression qu’elle est la première femme sur terre. Donc j’espère que Thierry arrivera à être le premier homme sur terre. (rires). Pas très modeste comme ambition ! (rires encore).