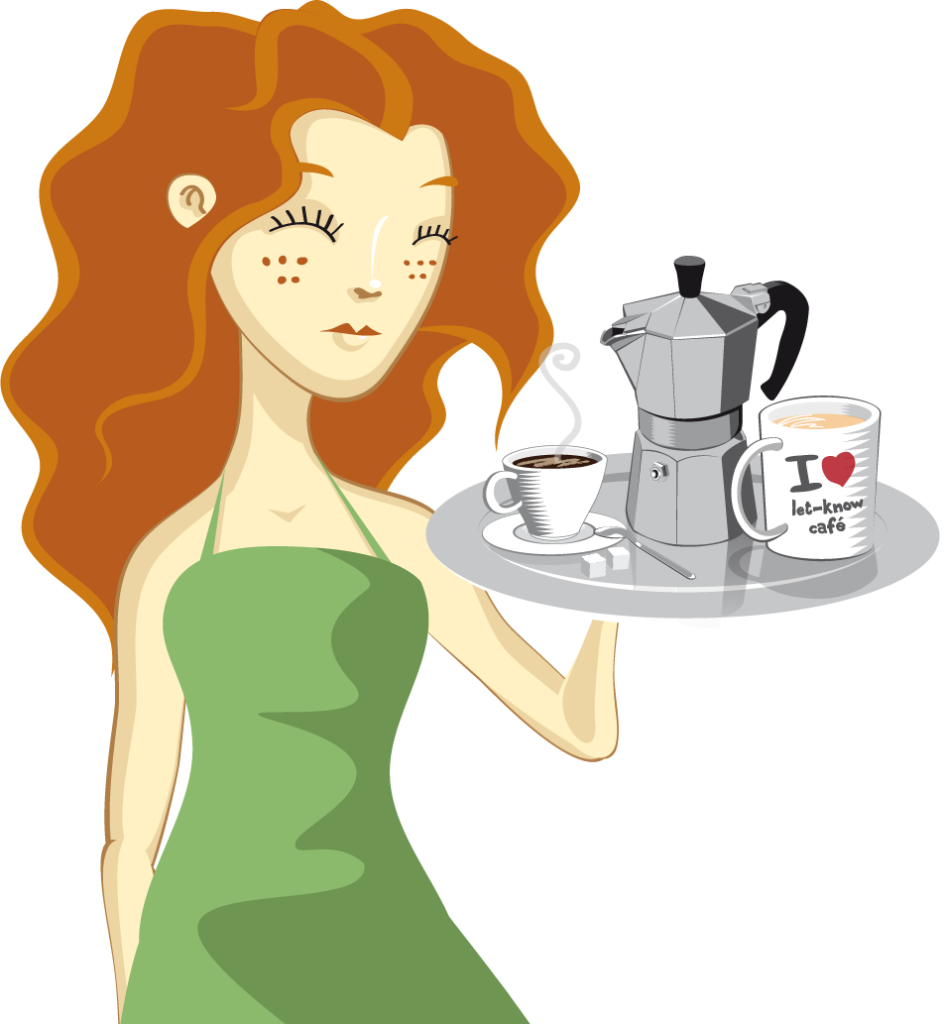Joséphine Brindherbes avait décidé de guérir, mais d’autres n’étaient pas d’accord (audio)
Jean Faya
28 mai 2015
— « Bonsoir docteur, c’est madame Brindherbes au téléphone. Je suis confuse de vous déranger en fin de journée. »
— « Je vous en prie », répond le docteur Lucas M. « Que vous arrive-il ? »
— « Docteur, je me sens faible, je tousse beaucoup, je pense avoir de la fièvre et je suis incapable de sortir de mon lit. Pourriez-vous passer ? »
— « Vous croyez que c’est nécessaire ? », rétorque son médecin généraliste. « Il est déjà tard et j’ai encore du monde. »
— « Oui, je préfèrerais, je suis inquiète. »
— « Heu… Bon… Oui, je peux faire en sorte… Je passerai après mes dernières consultations, un peu tard entre 20h et 21h. »
Lucas M. raccroche. Il râle un peu… C’est le pire pour lui : la visite qui s’annonce en début de soirée, suffisamment urgente pour ne pas pouvoir la refuser, juste au moment où il sent que la journée de travail touche à sa fin. Mais Lucas sait que Joséphine vit seule. Et si elle pense ne pas avoir la force de se lever, c’est à risque d’accident pour elle. Il ne pouvait négocier davantage. Le médecin raccompagne le dernier patient à la porte. Il ferme le cabinet, sort son vélo, y accroche sa trousse de visite, se hisse péniblement sur les pédales et attaque la pente. La nuit est tombée depuis quelques heures déjà. Il fait un froid glacial de février. Dur. Il arrive chez la patiente. Il salue poliment le fils aîné qui est là. Ce dernier le remercie du « dérangement » et l’accompagne au chevet sa mère. Joséphine Brindherbes a 95 ans. Elle est une grande femme de bonne éducation et de vigueur. Elle a le cheveu blanc et le regard vif qui accroche celui de son interlocuteur sans le lâcher ensuite. Elle explique à son médecin ce qu’elle ressent. Lucas l’examine. Il diagnostique une infection pulmonaire, et prescrit du repos au lit et un antibiotique. Il donne quelques consignes à son fils pour la nuit, encaisse les 33 euros, et retourne à coups de pédales glacées à son cabinet, ranger ses affaires avant de regagner son domicile à 21h30. Quelques heures plus tard, Joséphine Brindherbes est allongée dans le noir malmenée par la fièvre. Elle décide quand-même de se lever comme elle le fait chaque nuit. Mais elle ne souhaite pas réveiller son fils pour ça, même si il a décidé de dormir chez elle pour la veiller. Ce serait gênant. Elle sort de son lit, se met debout. Après quelques pas, catastrophe. Elle s’effondre sur elle-même, se fracture net le col du fémur, et se retrouve quelques minutes plus tard dans le camion des pompiers.
Le lendemain soir, Lucas lui rend à nouveau visite, cette fois à l’hôpital. Il retrouve sa patiente très affaiblie et contenue dans un grand lit métallique aux draps d’un jaune clair impeccable. Elle se fera sûrement opérer demain. « Je veux guérir ! Vais-je m’en sortir, docteur ? » lui dit poliment Joséphine. Lucas sourit pour masquer une hésitation. « Vous êtes solide. » finit-il par lui dire, sans grande conviction. Lucas M. prend congé de Joséphine Brindherbes en pensant qu’il ne la reverra probablement pas. Les fractures du fémur à cet âge sont redoutables. Il le sait. Madame Brindherbes reste quinze jours hospitalisée. Le chirurgien attend au final six jours pour réparer son fémur, le temps que l’infection pulmonaire soit guérie. Puis il l’opère un peu comme on joue au poker. Et Joséphine se réveille, très faible, mais bien en vie. Une fois les suites opératoires passées, la patiente est transférée dans un centre hospitalier périphérique connu pour ses soins gériatriques de qualité et ses prises en charge palliatives.
Une fois installée dans sa nouvelle chambre, Joséphine Brindherbes est dans un état stationnaire. Elle est trop faible pour assumer la moindre tâche pour son entretien mais encore assez forte pour s’exprimer et dire son souhait de rentrer chez elle. Elle pense qu’alors, elle ira mieux. Elle insiste depuis son lit, auprès de chaque soignant qui passe, et auprès de chacun de ses enfants. Elle arrive même à appeler son médecin traitant pour lui dire qu’il faut qu’il la sorte d’ici sinon elle va mourir. Elle est d’une cohérence limite et Lucas l’encourage à poursuivre les soins, lui dit que le centre est de très bons services. Mais Joséphine décline, dans le scénario classique des personnes âgées dans sa situation post-chirurgicale. Nul doute qu’elle va mourir. Son mari lui, est mort il y a 10 ans, aussi dans un hospice suite à une chute. Elle a eu avec lui 3 enfants : un fils, Jacques, puis une fille, Hortense, et un deuxième garçon, Luc, décédé cinq ans plus tôt dans un accident de la route. C’est le fils de ce dernier, Thierry, comptable, qui aide la patiente dans la gestion de ses affaires. Jacques et Hortense sont très présents, même si leur âge commence déjà à les ralentir un peu. Ils comprennent que leur mère arrive en bout de course et veulent suivre scrupuleusement ses dernières volontés. Leur père avant de mourir leur avait demandé de bien s’occuper d’elle. Mais les soignants du centre disent que la patiente est trop fragile pour être transférée à son domicile, et que ce ne sera possible que lorsqu’elle ira mieux. Les enfants ne comprennent pas bien cette position et appellent Lucas M. Ce dernier écoute. Il commence depuis quelques temps à culpabiliser de ne pas être plus actif dans cette histoire, mais il a tellement de travail au cabinet qu’il n’a jamais le temps d’appeler. Il dit à la famille qu’il va parler au médecin chef de service du centre. Il arrive enfin, trois jours plus tard, à appeler le Dr Eve D. Elle lui explique que Joséphine n’est pas loin de la phase palliative du soin et qu’elle est trop faible ce jour pour un retour à domicile. Tout serait trop compliqué à organiser pour un bénéfice probablement nul, selon elle. La patiente risquerait même de mourir pendant le trajet. Elle est bien soignée ici, sous bonne surveillance. Lucas acquiesce mais lui dit qu’il est tout à fait prêt à prendre en charge la patiente si elle rentre chez elle, en hospitalisation à domicile. Les jours passent. Joséphine est au plus mal. Ses enfants et son neveu commencent à perdre patience. Le Dr D. est inflexible… À nouveau la famille contacte Lucas. Ce dernier trouve aussi que cette situation devient grotesque. Il rappelle l’hôpital gériatrique et tombe sur l’interne. Il s’énerve plus facilement contre ce tiers : « On est tous d’accord avec le fait que la patiente va mourir. Elle veut rentrer chez elle. Sa famille accepte le risque qu’elle meure pendant le trajet, alors où est votre problème ? ». « Moi, je suis d’accord avec vous », répond l’interne, « mais notre chef de service voit les choses d’un autre œil. Je vais en reparler avec elle. » Et le Dr D. est confraternellement contrainte de lâcher prise. Le lendemain s’organise le transfert. L’organisme d’hospitalisation à domicile (HAD) est sollicité. Tout se met en place rapidement et Joséphine rentre enfin chez elle dans l’après-midi, cinq semaines après sa chute, avec trois superbes escarres aux deux talons et au sacrum.
Joséphine Brindherbes est chez elle, mais dans un demi-état. Elle est agitée, confuse, presque grabataire. Elle semble essayer sans cesse de sortir du lit pour se lever. Heureusement qu’il y a les barrières. Le médecin du centre avait en plus suspecté une récidive d’un ancien cancer des cordes vocales, du fait d’une voix cassée. Elle avait confié à la famille que cela arrive souvent dans ces situations délicates. Vu l’état de la patiente, aucun examen n’a bien sûr été prescrit pour confirmer ce diagnostic. Mais du coup, il est clair pour tout le monde que Joséphine est maintenant en soins palliatifs et qu’il faut soigner au mieux son confort jusqu’à son trépas. Éric F. est le médecin coordinateur de l’HAD. Il est chargé du bon déroulement des soins, habitué de ces situations délicates. Il est censé travailler de concert avec le médecin traitant, mais du fait de son expérience en ces soins techniques, il prend souvent l’initiative de la prescription et est souvent sollicité en premier lieu par la famille et les infirmiers en cas de difficulté. Éric échange avec Lucas au téléphone. Ils travaillent à s’accorder sur les prescriptions. Lucas est bien d’accord avec ce que propose Éric qui se trouve chez la patiente, d’autant qu’il n’a, comme toujours, pas trop le temps de se déplacer. Joséphine se voit donc « protocolisée » selon l’usage quand on vit ses derniers instants : diurétiques, corticoïdes, oxygénothérapie et aérosols pour mieux respirer, scopolamine pour mieux vivre les râles de l’agonie, un anxiolytique et un patch de morphine pour gérer les douleurs morales et physiques des escarres notamment. Trois jours plus tard, un matin, Lucas reçoit l’appel de l’infirmière très inquiète. Madame Brindherbes est dans le coma, elle n’est plus bien réactive, même si elle semble douloureuse. L’infirmière demande s’il faut augmenter la morphine et poser une perfusion d’hydratation pour nourrir ses dernières heures de vie. « Je pense », répond Luca, « qu’il faut vérifier qu’elle n’est pas simplement en surdosage de médicaments. » Il demande à l’infirmière de stopper la morphine et les anxiolytiques. Il passera la voir ce soir. L’infirmière bougonne. Le soir venu, Lucas arrive chez la patiente. Elle est bien réveillée, esquisse un sourire et lui dit : « Non effectivement, ça ne va pas, je trouve que je ne progresse pas assez vite! » Lucas rit. Il réévalue son traitement et va jusqu’au bout de la stratégie qui semble payante et arrête 7 des 10 médicaments prescrits. Petit-à-petit, les jours passent. Joséphine récupère. Elle ne cesse de se plaindre qu’elle ne fait pas assez d’efforts, qu’elle devrait se lever, qu’il faut qu’elle marche. Elle s’accroche sans cesse avec son auxiliaire de vie qui panique à l’idée de ne pas pouvoir la ramasser en cas de chute. On lui impose toujours des barrières de chaque côté de son lit, et elle tente toujours de passer par-dessus. L’entourage évoque la possibilité de la contenir, autrement dit, de l’attacher sur son matelas. Lucas est sollicité sur la question, et passe la voir pour lui proposer comme contrat de ne pas se lever sans la présence de trois personnes chez elle. Elle acquiesce. Tout le monde est rassuré.
Une kinésithérapeute vient tous les trois jours. Joséphine trouve cela bien insuffisant pour retrouver son autonomie. Et la situation va durer ainsi plusieurs semaines. Mais Joséphine a repris suffisamment de forces pour tenir la position assise, puis la position debout le temps de quelques secondes. Les jours passent, de petits progrès en petit progrès, et le comptable de neveu commence à se tendre. Il trouve que l’organisation avec la garde de nuit coûte beaucoup trop cher, avec en plus les charges de l’appartement. La situation mange le capital familial. Une maison de retraite serait moins chère et, selon lui, plus adaptée : « Le plafond, ici ou en maison sera le même à regarder », lance-t-il un jour à Lucas. Il suggère l’idée à sa tante. Joséphine hésite. Elle entend l’argument financier, et le fait que son entourage est très sollicité. Elle en est très culpabilisée. Mais quand même, quitter son appartement où sont là tant de souvenirs avec son cher mari, n’a rien d’évident. Justement, une réunion de famille y est organisée sur le sujet. Lucas y assiste. Sont présents le frère, les enfants et le neveu de la patiente. Il est décidé que Mme Brindherbe ira visiter la maison de retraite où une chambre lui est d’ailleurs déjà réservée. Elle acquiesce : « C’est peut-être mieux ainsi. » Et le jour dit, elle fait quelques pas dans l’établissement, échange quelques mots poliment avec le directeur, et dit un non catégorique : « Non, ce n’est pas pour moi. » Son neveu est furieux et ne lui adressera plus la parole pendant des mois. Quelques jours plus tard, Lucas en visite chez elle, croise du regard sur le bureau de la chambre de la patiente, un mot écrit à la main. Croyant qu’il lui est adressé, il lit la fin rapidement. C’est en fait le journal de Joséphine. Elle y écrivait à 96 ans : « Je comprends juste aujourd’hui combien il est difficile de se mettre à la place des autres. »
Joséphine Brindherbes a fait effort tout le long, pour se libérer des avis des uns et des autres, en rappelant la possibilité qu’elle vive encore, voire son droit à vivre encore. Et pour cela, elle a cherché de l’aide, de l’accompagnement, de la sollicitude, de l’aménagement pour son environnement. Elle avait besoin que d’autres soient non seulement solidaires, mais en soucis pour elle, avec encore un peu de goût pour son contact, qu’ils croient dans son projet. Face à ça, Joséphine Brindherbes est restée souvent seule : Lucas n’a jamais le temps. Eve la veut hospitalisée. Éric la veut sédatée. Et le neveu, lui, la veut déménagée. Elle n’a trouvé aucune solidarité pour son projet de vie car beaucoup avaient décidé qu’elle « devait » mourir, comme dans un ordre des choses. Chacun ici a fait son métier comme il faut. La qualité technique des soins a toujours été au rendez-vous. Ce soin-là les obligeait de toute façon et ils ont assumé leurs responsabilités. Dans l’introduction générale du récent livre « Autour du soin »[1] coordonné par Thomas Pierre, Saïd Megherbi avance que « le soin suppose une équivalence avec la maladie. Le modèle de soin lorsqu’il existe, légitime la maladie à laquelle il s’applique et traite. En d’autres termes, la maladie n’existe que par le modèle de soin qui lui est proposé. « Maladie » et « soin » ne sont en définitive que les deux faces d’une même pièce…» Les modèles de soins de chaque soignant ont généré des maladies, du cancer des cordes vocales, à l’agonie imminente. Et chacun y a trouvé le sens qu’il voulait. « Ainsi, les malades, quelque soit finalement la définition qu’on donne à la maladie, doivent être secourus, on leur doit assistance. Les sociétés ont toujours des politiques censées répondre à la maladie, au malheur qui en résulte avec des dispositifs devant prendre en charge les individus les plus fragiles afin de leur apporter des réponses en termes de soins […]. Au « soin » proprement dit, celui que l’on pourrait appeler « cure », s’est adjoint progressivement une autre dimension, celle du « care » que l’on pourrait définir ici par « prendre soin. » Oui il y a bien une perspective du « care » chez tous les intervenants de notre histoire. Ils semblent bien être des « care givers ». Ils ne se limitent pas aux soins techniques. Pour Sandra Laugier[2], l’importance du care, « c’est reconnaître que la dépendance et la vulnérabilité sont des traits de la conditions de tous ». Chacun a investi la relation avec Joséphine dans ce sens. Il y avait malgré tout toujours de la confiance, des espaces de dialogue. On ne peut pas parler non plus de domination ou de hiérarchie. Mais il n’y avait pas pour autant une égalité, dans le sens d’un socle commun d’humanité, celui où chacun est dépouillé de son identité imaginaire, pour se laisser altérer par la rencontre, qui fait émerger quelque chose de vivant entre chacun. En fait chacun est resté empêtré dans son identité « imaginaire », ou « construite » en tout cas. Du « care » comme « prendre soin », il ne semble rester que le « prendre ».
Car là, le soin semble bien recouvrir quelque chose que l’on cherche à prendre à l’autre, comme un bien que l’on se dispute. Et quand les soignants se disputent le soin en tirant vers eux tant qu’ils le peuvent la corde à nœuds, Joséphine, elle, fait de même. Elle fait tout pour récupérer son soin, et le mener dans son sens. Il s’agit bien là d’un affrontement. « Les mondes privés »[3] des soignants, se mènent une guerre d’influence, quand la patiente dans son monde à elle, lutte pour ne plus être l’objet d’un marchandage et cherche à exister en tant qu’elle-même, se laisser toucher par l’autre, et non pas effleurer… Chacun défend là son identité. Chacun là, règle avec le voisin ses rapports de pouvoir. Et le « care » lui, ne résiste pas à cette guerre des mondes. Et de toute l’expérience de ses 96 ans, Joséphine nous donne la clef : « Je comprends juste aujourd’hui combien il est difficile de se mettre à la place des autres. » Ce qui importe en tout cas, et qui nous réjouit, c’est que je vous l’assure, Joséphine Brindherbes est bel et bien guérie.
[1] PIERRE Thomas (2014). Autour du soin. Pratiques, représentation, épistémologie. Nancy : Presses universitaires de Nancy, p.11-13
[2]LAUGIER Sandra (2010). Le care : enjeux politiques d’une éthique féministe, http://www.raison-publique.fr/article203.html (consulté le 8 avril 2015).
[3]MERLEAU-PONTY Maurice (1964). Le visible et l’invisible. Paris : Gallimard, 359 p.