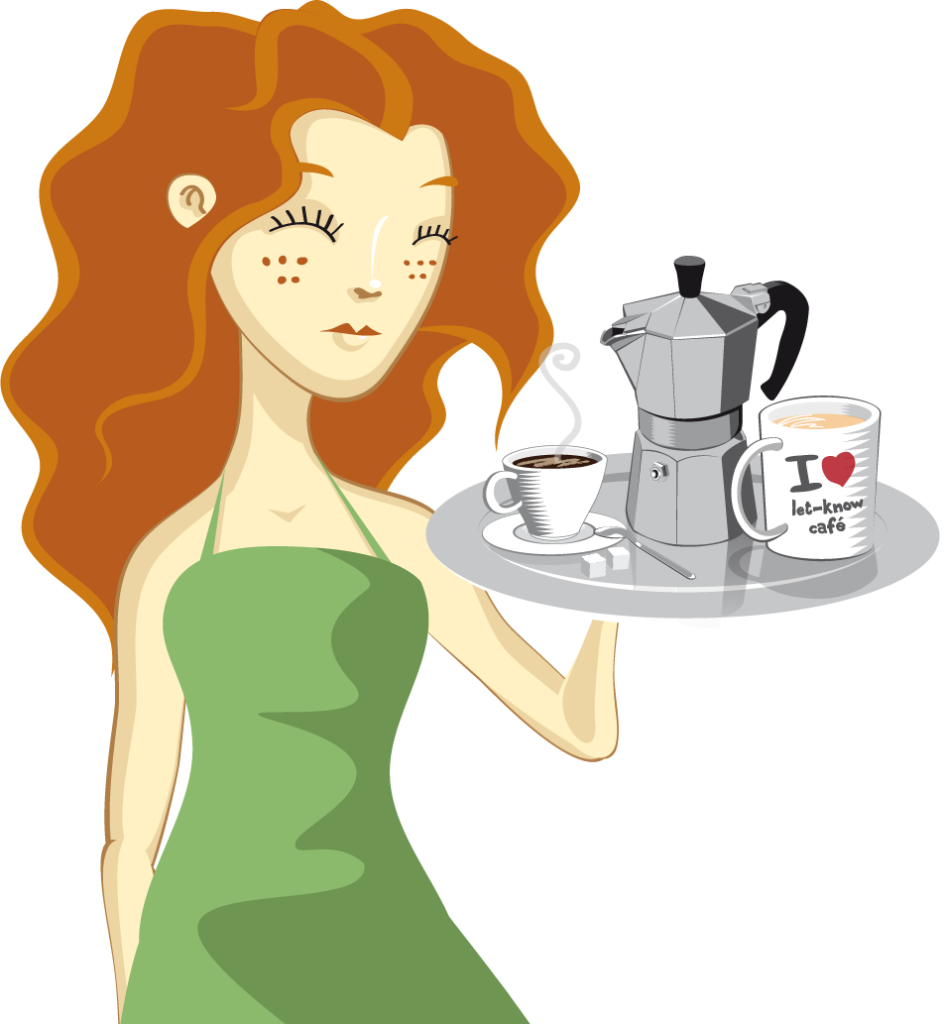Medhi et son dragon (audio)
Jean Faya
25 novembre 2014
C’est Mme Marthe R., l’assistante sociale du secteur, qui un jour prend son téléphone pour appeler le Dr Lucas M. médecin généraliste du même quartier. Elle explique avoir identifié un homme, âgé de 90 ans, Mr Mehdi B., qui vit seul au dernier étage d’un immeuble complètement vétuste. Il habiterait une petite pièce dans un état d’insalubrité à peine croyable. Mr B. est originaire du Maghreb et parle peu français. Même si la communication est difficile, l’assistante sociale comprend qu’il n’a pas de médecin traitant. Marthe propose à Lucas d’organiser une visite. Rendez-vous est pris au pied de son immeuble. Marthe et Lucas se retrouvent et s’engagent dans l’allée noirâtre. Les deux professionnels grimpent les escaliers. Les murs intérieurs de l’immeuble sont d’une couleur indéfinissable, entre le gris, le noir et le marron, comme s’il venait d’y avoir un incendie. Le souffle un peu court, ils arrivent devant la porte-palière du cinquième. Il y a là quelques sonnettes auxquelles correspondent quelques noms à moitié lisibles sur leurs vieilles étiquettes. Lucas est étonné de lire : « Mr B., écrivain public ». Ils sonnent. Et quelques instants après, Mr B. apparaît tranquillement. C’est un homme de taille moyenne, le corps maigre semblant flotter dans une propre chemise, une large veste bleu roi et un pantalon au pli bien droit. Madame R. fait les présentations. Medhi y répond par un sourire poli, sans mot dire, et accepte de les recevoir dans son appartement. Effectivement, la scène est saisissante. Mr B. vit dans une pièce tout en long se terminant par une fenêtre. Tout de suite à droite se tient son lit, un matelas à même le sol, sans draps, ni couette, avec seulement deux vieilles couvertures semblant étendues dans le désordre. À gauche, la moitié de la pièce est occupée par une quinzaine de grosses valises, bien rangées, fermées les unes contre les autres. Plus au fond, avant la fenêtre, il y a l’espace « cuisine ». L’évier est chargé d’un entrelacs de divers objets : assiettes, casseroles, bouteilles… Il semble ne pas servir depuis longtemps. Au sol, une trentaine de bouteilles de lait plus ou moins pleines sont rassemblées. Tout cela baigne dans une bonne couche de crasse, et on peut voir si l’on y prête attention, un ou deux cafards affairés. L’odeur n’est pas vraiment désagréable, mais se résume à un air de renfermé, concentré. L’assistante sociale semble lutter contre une certaine sensation de malaise devant cette scène-là. Lucas paraît dans le même état. Elle engage la conversation autour des questions administratives. Elle tente de comprendre la situation des revenus de Medhi, de son assurance maladie. Elle lui explique, que s’il est d’accord, Lucas M. sera son nouveau médecin. Le patient hoche la tête à chaque question. Il semble ne pas bien comprendre le français. L’assistante sociale lui dit qu’il paraît difficile de vivre dans de telles conditions, qu’il faut trouver une solution. Le patient acquiesce en désignant son lit, en s’énervant un peu contre le propriétaire, « un voleur ». La conversation se poursuit quelques instants, puis Marthe et Lucas prennent congé de Mehdi B. Que se passe-t-il donc à cet instant-là ? Quelle perception ont ces trois-là du logement de Mr B. ? Marthe, Medhi et Lucas sont-ils tous d’accord sur la situation ? Sont-ils tous d’accord pour dire que Mr B. doit changer au plus vite de conditions de vie ?
Cette histoire-là est l’occasion de remettre à la lumière le livre de Maurice Merleau-Ponty[1], philosophe français, Le visible et l’invisible. En tant que médecin, en tant qu’assistante sociale, en tant que personne humaine, en tant que chercheur, on a spontanément tendance à penser que le monde est tel qu’on le voit. Pour Merleau-Ponty, les choses ne sont évidemment pas si simples.
« Il paraît impossible […] d’en rester à la certitude intime de celui qui perçoit : vue du dehors, la perception glisse sur les choses et ne les touche pas. »
« Tout au plus dira-t-on, […] que chacun de nous a un monde privé : ces mondes privés ne sont « mondes » que pour leur titulaire, ils ne sont pas le monde. » (p.25)
Le monde de Mr B. n’a-t-il pas d’autres couleurs que le gris-noir-marron-crasseux ?
« Ce qu’il y a donc, ce ne sont pas des choses identiques à elles-mêmes qui s’offriraient au voyant, et ce n’est pas un voyant, vide d’abord, qui, par après, s’ouvrirait à elles, mais quelque chose dont nous saurions être plus près qu’en le palpant du regard […]. » (p. 171)
Cette manière de ne voir (de ne palper) qu’une pièce grise, noir, crasseuse, n’empêche-t-elle pas de voir plus justement ce qui s’y trouve ?
« Le regard, enveloppe, palpe, épouse les choses visibles. […], comme s’il les savait avant de les savoir. » (p. 173)
Ainsi, observer a un objectif qui inévitablement influence la façon dont nous observons. Marthe et Lucas ont tendance à voir en premier les choses qui semblent coller avec leurs propres objectifs, avec ce qui a du sens, ce qui « fait » sens. Les phénomènes observés le sont toujours à travers les yeux de l’esprit, c’est-à-dire à travers « le filtre des idées préconçues de l’observateur »[2].Que peut-on dire des mondes privés de Marthe, Lucas et Medhi, ces inconnaissables ? On peut imaginer Marthe prise dans sa mission de protection de la personne âgée, de garantir à chacun un logement décent et un environnement propice à la santé. Probablement que son existence personnelle et son histoire sont en accord avec ces impératifs, puisqu’ils l’ont conduite vers ce type de métier. On peut imaginer Lucas, pris dans les consignes de la médecine moderne où l’hygiène est la condition à la bonne santé et à l’absence de maladie. Il est même bon de penser que l’hygiène aurait plus d’effet que la vaccination. Et qu’imaginer de l’énigmatique Medhi B. ? Difficile d’envisager le monde de celui-là, cet écrivain public qui semble ne pas savoir s’exprimer, ce gardien de multiples valises pleines au contenu mystérieux. Nous ne savons que peu de choses sur lui. Un voisin de passage dit qu’il passait régulièrement le raser, car Medhi B. fut un « grand soldat » qui avait combattu sur tous les champs de bataille de l’armée française de l’Allemagne nazie à l’Indochine, en passant par d’autres tranchées et qu’il l’admirait pour cela. On peut penser que Medhi voit la crasse différemment de Marthe ou Lucas, si son monde fut celui des tranchées.
Cela nous amène à éclairer un deuxième livre, celui de Tim Ingold[3], anthropologue anglais, Marcher avec les dragons. L’auteur s’interroge sur ce que nous entendons par environnement, terme qui devient pour lui relatif.
« C’est-à-dire relatif à l’être pour lequel il est un environnement. Mon environnement est donc le monde, [oui, mais…] tel qu’il existe et acquiert une signification par rapport à moi. » (p. 28)
Si chacun de nos trois protagonistes avait décrit la maison de Mehdi, aurions-nous pu comprendre que tous trois parlaient du même endroit ?
Tim Ingold évoque l’écologie du sensible pour la façon de décrire un environnement.
« Il ne s’agit pas d’une connaissance formelle, institutionnelle, transmissible hors du contexte. [Ce n’est pas de la reprographie]. Au contraire, elle s’appuie sur une façon de sentir qui est constituée par les capacités, les sensibilités et les orientations qui se sont développées à travers une longue expérience de vie dans un environnement particulier [grandir dans une maison bien tenue, passer sa vie dans les tranchées…]. » (p. 37)
L’auteur parle ainsi d’une poétique de l’habiter (p.38). Et oui, l’habitat de Medhi est poésie car il émeut, il éveille la sensibilité, il provoque des sensations chez Marthe et Lucas, par ses caractères originaux.
Ainsi, selon Tim Ingold,
« Nous percevons notre environnement en fonction de ce qu’il nous offre dans la poursuite de l’action dans laquelle nous sommes engagés. » (p. 137)
La thèse fondamentale de l’auteur est que la vie est donnée dans l’engagement.
« Nous percevons le monde au cours de nos actions, et parce que nous y agissons. » (p. 139)
Et c’est bien ce que vont faire Marthe et Lucas. Ils passent à l’action. Les jours se suivent mais la pression monte. Lucas a fait quelques visites à Medhi B., surtout l’occasion de manifester sa présence, et Mme R. a fait de même, aussi pour organiser une sauvegarde de justice auprès du juge des tutelles. Il est pour chacun une petite culpabilité qui grandit, une sorte d’impératif qui s’impose, celui de sortir Medhi B. de cette situation. Mais l’affaire est compliquée. Il faut nettoyer l’appartement avant de faire intervenir une auxiliaire de vie et l’entreprise de nettoyage ne veut pas intervenir tant qu’il y a des insectes. Mme R. craque la première et téléphone à Lucas. « Il faut que nous fassions quelque chose. Peut-être faut-il que nous organisions une hospitalisation ? » Lucas n’est pas contre le principe. Il n’a pas réussi à organiser un bilan biologique en ville, le patient semblant mal comprendre ou étant peu motivé. Le médecin et l’assistante sociale se décident à retourner voir ensemble pour la deuxième fois Mr B. Après avoir escaladé jusqu’au 5ème étage, coup de sonnette. Les intervenants expliquent à Mr B. qu’ils aimeraient qu’il fasse un bilan de santé à l’hôpital, juste pour voir si tout va bien. Mr B. est dubitatif, mais semble acquiescer poliment. Se pose alors la question du transport. Ses droits à la sécurité sociale ne sont pas encore ouverts, l’attestation n’est pas arrivée et il n’a pas d’argent pour payer. On se propose d’appeler le 15 pour tenter de bénéficier du service d’une ambulance par leur biais. Le médecin régulateur est compréhensif et envoie un véhicule. Mr B. les voit agir et comprend mieux la situation. Il devient plus nerveux. Il ne veut pas partir de chez lui et il formule un non clair et catégorique. Les deux se regardent ennuyés. L’assistante sociale propose discrètement à Lucas d’avoir recours « au péril imminent », cette nouvelle disposition d’hospitalisation sous contrainte. Lucas M. lui est perplexe. C’est à lui de décider de la démarche. Y a-t-il péril imminent ? La pièce est très sale, mais le patient même sans examen, semble en bonne santé. Il hésite. Espérons que devant les ambulanciers, Medhi B. changera d’avis. Au loin, on entend les sirènes d’un véhicule de pompiers qui approche. La situation devient surréaliste. Le centre 15 n’a pas dû trouver d’ambulance privée et a dû faire appel à une équipe de pompiers. Quelques minutes plus tard, quatre pompiers pénètrent dans l’appartement. Mr B. est droit dans ses chaussures et refuse de partir. Tout le monde se tient là, debout, quelques secondes dans le silence. Les regards passent des uns aux autres pour tenter de décrocher des réponses à la situation bloquée. Lucas imagine donner le feu vert pour le « péril imminent » et les quatre gaillards saisir manu militari Mr B. Impossible. Finalement Lucas renonce. Il ne fera pas les démarches d’hospitalisation sous contrainte. Il remercie les pompiers et leur présente ses excuses pour le dérangement. L’équipe s’en va. Marthe et Lucas échangent encore quelques mots avec Medhi. Puis ils redescendent l’un et l’autre perplexes sur les décisions prises. Il y a un sentiment un peu amer de raté ou en tout cas d’impuissance. Mais c’est par leur engagement que Medhi s’est révélé, soudain plus loquace, et aussi son dragon. Car oui, peut-être l’avez-vous reconnu, il y a bien un dragon dans l’histoire.
« Les dragons, ça n’existe pas. C’est le titre d’un des grands classiques de la littérature pour enfants, écrit par Jack Kent[4]. Il raconte l’histoire d’un petit garçon, Billy Bixbee, qui se réveille un matin et découvre un dragon dans sa chambre. Il est assez petit, et remue la queue de façon plutôt amicale. Billy va prendre le petit déjeuner avec le dragon, qu’il présente à sa mère. « Les dragons, ça n’existe pas », déclare-t-elle sur un ton ferme tout en continuant à préparer des pancakes pour le petit déjeuner. Billy s’assied à la table du petit déjeuner tandis que le dragon s’assied sur la table. Il n’est normalement pas permis de s’assoir sur la table dans la maison des Bixbee, mais il n’y a rien à faire, car si les dragons n’existent pas, vous ne pouvez pas leur dire de descendre de la table. Le dragon a faim et mange la plupart des pancakes, mais cela ne dérange pas Billy. Alors que sa mère continue à ignorer le nouvel arrivant, le dragon commence à grandir. Il n’arrête plus de grandir. Il occupe bientôt toute l’entrée, et la mère de Billy a du mal à nettoyer la maison car elle ne peut plus aller d’une chambre à l’autre qu’en passant par les fenêtres. Toutes les portes sont bloquées. Le dragon continue de grandir – il est désormais aussi grand que la maison. Puis la maison est soulevée et transportée dans la rue sur le dos du dragon. Le père de Billy, de retour du travail, est surpris de découvrir que sa maison a disparu. Mais un voisin lui vient en aide et lui indique la direction qu’elle a suivie. Au moment où la famille finit par se réunir, la mère de Billy a reconnu à contre cœur que le dragon, après tout, existait peut-être. Le dragon commence alors immédiatement à rétrécir jusqu’à ce qu’il ait trouvé une taille raisonnable. « Les dragons de cette taille ne me dérangent pas », reconnaît Mrs Bixbee alors qu’elle est confortablement assise dans un fauteuil en train de le caresser. » (p. 356)[5]
La morale de cette histoire bien entendu, est que des problèmes qui sont initialement sans importance, si nous avons peur de les reconnaître ou de les désigner par leur nom, par peur d’enfreindre les normes de la conduite dite rationnelle, peuvent s’aggraver au point de bouleverser notre vie sociale ordinaire. Le problème ici est bien : qu’est-ce qui conduit Mr B. à accepter de vivre dans cet environnement crasseux ? Même si on l’ignore, la raison existe, en partie sûrement cachée dans ses 15 valises. Elle est le dragon de l’histoire ! Marthe et Lucas, ne voient pas le dragon (la raison d’être de Medhi B.) qui grossit à son paroxysme devant les pompiers au point de mettre en échec leur démarche. Peut-être que personne n’a envie de vivre dans la crasse, mais ce débat autour de la crasse de Marthe, Lucas et Medhi dépasse la crasse elle-même. Le débat autour de la crasse est l’histoire de la rencontre des mondes de chacun et des enjeux entre chacun.
Cette histoire nous amène à lire les choses et à écrire autrement sur elles, à réparer « la rupture entre l’être et la connaissance » (p. 356), soit réparer la rupture entre l’être (Mr B.) et les connaissances hygiénistes de Marthe, et la soi-disant rationalité scientifique conventionnelle de Lucas. Entre la crasse et le dragon, il s’agit de ne pas tomber dans la démesure, ou en tout cas de savoir en revenir, si notre histoire nous y a entrainé. « Par cette réparation alors, peut-être le dragon se calmera. » (p. 356)
[1] MERLEAU-PONTY Maurice (1964). Le visible et l’invisible. Paris : Gallimard, 359 p.
[2] FLECK Ludwig ([Ed. originale 1934], 2005). Genèse et développement d’un fait scientifique (traduit par Nathalie JAS). Paris : Les Belles Lettres. p. XX
[3] INGOLD Tim (2013). Marcher avec les dragons. Paris : Zone sensible, 2013, 379 p.
[4] KENT Jack [1976] (2011). Les dragons, ça n’existe pas. Namur : Mijade.
[5] INGOLD Tim (2013). Marcher avec les dragons. Paris : Zone sensible, 2013, 379 p.