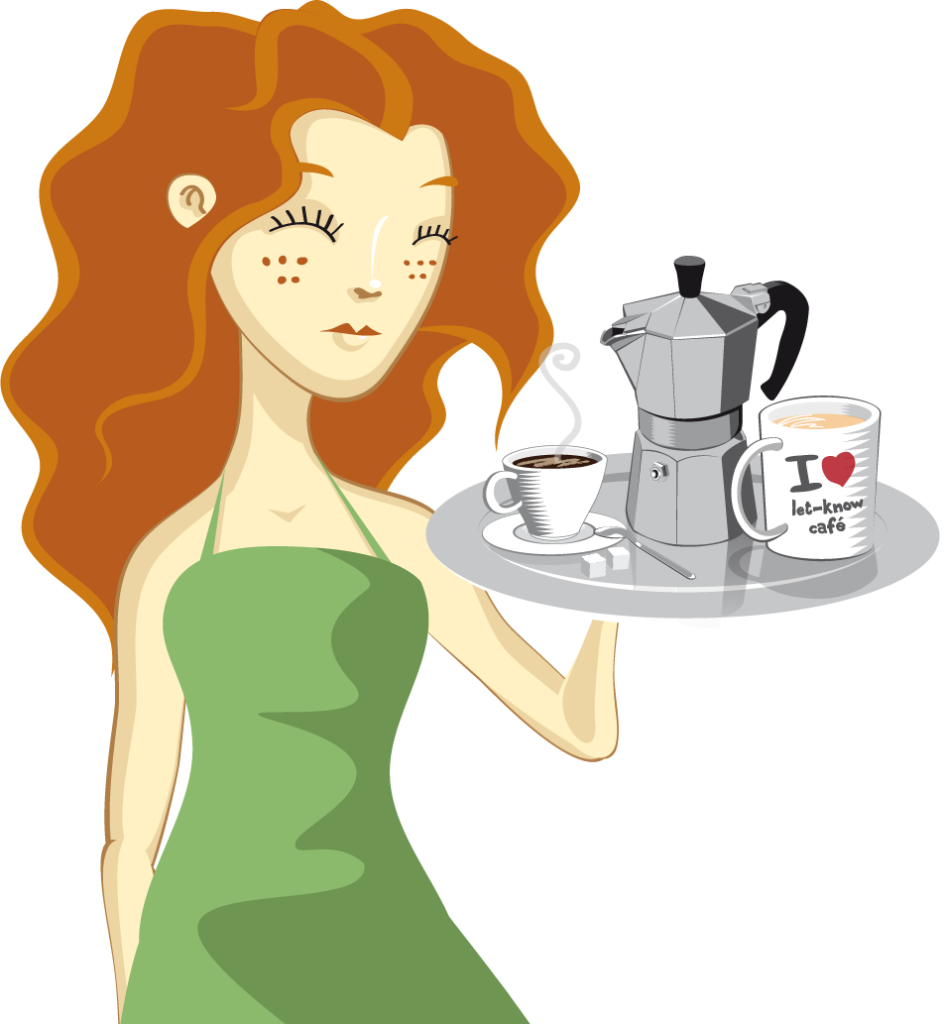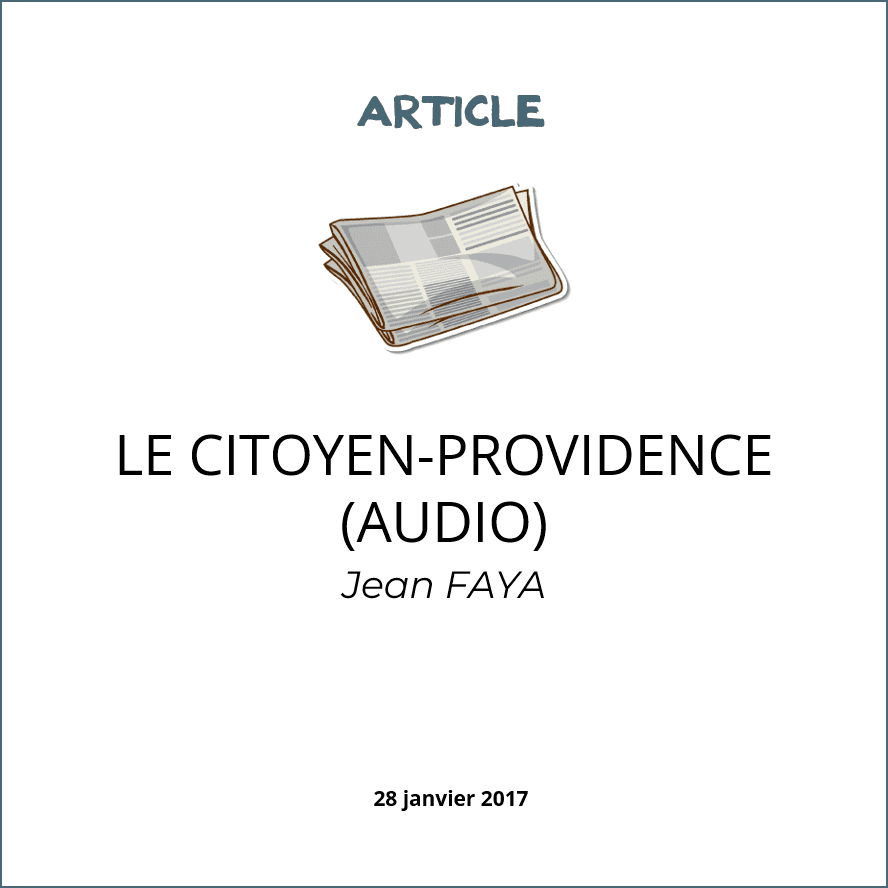
Le citoyen-providence (audio)
Jean Faya
28 janvier 2017
– « Arrhhh, ils m’agacent, Louis et ses potes gauchos, à toujours tout critiquer. Comme si ils pouvaient faire mieux, eux ! Le marché a ses contraintes, l’économie est en crise… C’est pas si simple bon sang ! »
– « Allez, tu t’énerves à chaque fois de la même façon. Il n’y a que la vérité qui fâche, non? »
Charles sourit en lançant une vilaine grimace et agrippe Lucile pour lui pincer les côtes. Il sait qu’elle a horreur de ça. Elle sursaute. Elle saisit son bras pour l’interrompre en ronchonnant, et d’un petit bond en avant, elle se retrouve à marcher d’une vive allure, à deux pas devant lui, hors d’atteinte de ses coquineries.
Lucile et Charles rentrent d’une soirée bien arrosée chez des amis, Louis et Laure. Ils habitent avec leurs deux enfants sur le toit d’un immeuble, dans un appartement avec une vaste terrasse qui domine tout Lyon. Louis travaille dans une structure qui gère des logements sociaux. Il côtoie de fait un milieu bien étranger à Charles. Charles lui, est architecte. Il a à peu près quarante ans, grand, brun, le teint mate et les cheveux très courts, d’où sont accrochées des petites lunettes fines, rondes et métalliques. C’est un homme gai et dynamique, pour qui les problèmes ne sont pas vraiment des problèmes et les solutions toujours à portée de ses neurones. Le monde est pour lui un monde concret, à la structure bien définie et facile à lire. Lucile est un peu plus âgée que Charles. Elle est d’une taille moyenne, les cheveux mi-longs, châtains, la peau claire. Elle peut donner l’impression d’être parfois mal assurée, en tout cas moins que Charles. Elle est plus introvertie. Elle aime la philosophie et les débats infinis sur le sens de la vie et la forme du monde. Hier encore, elle écoutait sur les archives du net, une interview de Michel Foucault, qu’elle adore lire et écouter, sur l’utopie du corps. Charles lui n’aime pas bien Foucault. Il trouve sa pensée méandrine et assez incompréhensible.
Lucile aime cette différence entre eux deux. Elle aime son homme, son énergie, la force tranquille qu’il semble toujours dégager. Il la rassure finalement par le monde simple qui semble être le sien. Mais parfois elle peut le trouver limité dans ses analyses, et en être du coup agacée. Elle se l’est dit hier en écoutant Foucault : pour son homme, rien n’est utopie. Il n’est pas de lieu hors de tous les lieux, pas de corps hors de son corps. Son homme est ancré dans le sol. Et il n’est d’autre ciel que le sien propre, « mon corps, topie impitoyable » dit Foucault au début de sa démonstration. Il parait impensable pour l’homme de Lucile d’appréhender le monde autrement que par la grille de son anatomie, lieu sans aucun autre recours. Avec Charles, il n’est pas de pays des fées, des lutins et des génies. Il n’est pas non plus d’âmes ni de pays des morts.
Charles marche donc derrière Lucile. Il reluque avec délice le mouvement gracieux de ses fesses arrondies. Il se dit qu’il a de la chance. Il regrette un peu d’avoir trop bu, et d’être moins en capacité une fois leur chambre retrouvée. Ils avancent tous deux ainsi dans le grand hall de la gare de la Part-Dieu pour rejoindre l’autre côté du quartier. Il est une heure du matin. Ils passent devant la salle d’attente des voyageurs. Trois agents de la SNCF sont visiblement en train de faire sortir les cinq personnes qui s’y trouvent. Celles-ci se dirigent dans la nonchalance vers la sortie, traînant avec elles leurs quelques sacs et effets personnels. Charles et Lucile arrivent à leur niveau. Lui éméché, lance joyeusement à l’une d’elle :
– « Il n’y a plus de train ? »
– « Je n’attends pas de train » lui répond la jeune femme d’une voix faible, douce et calme, dans un net accent africain. Elle a peut-être 23 ans, la peau très noire, les cheveux coiffés de fines tresses remontées en chignon. Elle en impose autant par sa grande taille que par sa très forte corpulence.
– « Mais vous êtes dans une gare ici! », lance Charles goguenard.
– « Oui, c’est une gare où je dors jusqu’à la fermeture. Bonne soirée. »
Charles et Lucile se regardent sans trop comprendre.
– « Elle est complètement tarée celle-là? » dit Charles en regardant Lucile.
– « Arrête, elle est peut-être SDF. »
Ils poursuivent leur marche, pensifs et en silence, jusqu’à leur appartement. Une fois arrivés, ils remercient la baby-sitter. Et, assez dégrisé par la rencontre fortuite de la gare, Charles retrouve leur chambre et propose son désir à Lucile. Ils font l’amour avant de s’endormir.
Le lendemain matin, Charles et Lucile se retrouvent au petit-déjeuner avec leurs deux petites filles, Léa et Brune. Entre la préparation du biberon de Brune et du chocolat chaud de Léa, Charles essaie de désengluer ses neurones des excès d’alcool de la veille. Il repense à la jeune femme noire d’hier soir. Est-elle timbrée ? Mais en même temps son discours avait l’air cohérent ! Elle semblait tranquille, posée, dans la maîtrise de cette situation saugrenue. Peut-être s’est-elle juste foutue de lui et de sa curiosité ébrieuse ? Mais peut-être que Lucile a raison, et qu’elle n’a effectivement pas de domicile. Charles passe sa journée au travail et tourne en boucle ces questions dans sa tête. La troisième hypothèse lui semble, au fur et à mesure que les heures passent, la plus probable. Mais comment peut-on être à la rue lorsque l’on est une jeune femme de peut-être 23 ans, en France ? Il se dit qu’elle doit être une de ces migrantes, dont on parle à la télé, et qu’elle ne doit pas trop savoir où aller. Il tapote sur internet, voit quelques pages sur le droit d’asile, sur les associations locales qui s’occupent des réfugiés, sur les centres d’accueil. Il prend deux trois notes. Il rentre le soir chez lui et une fois les enfants couchés, explique son analyse et expose le fruit ses recherches à Lucile. Charles souhaite retourner voir la jeune femme ce soir pour lui donner les infos. Lucile lui sourit tendrement et le prend dans ses bras.
– « Tu sais, elle a sûrement déjà des gens qui la conseillent. Mais tu as raison. Pourquoi ne pas lui en parler, au cas où. Je t’accompagne. Ça me fera faire un tour. Je vais demander à notre petite voisine si elle ne veut pas venir comater une demi-heure sur le canapé le temps que l’on revienne. »
La voisine installée, et les petites couchées, Charles et Lucile reprennent le chemin de la gare, vers 22 heures. Ils aperçoivent la jeune Africaine en salle d’attente en train de somnoler sur un siège, la tête appuyée contre le mur, sur l’un des fauteuils d’un carré de quatre places qu’elle occupe seule, sous la lumière assez chaleureuse pour l’endroit, d’une lampe de chevet à la mode SNCF. Ils s’approchent d’elle.
– « Mademoiselle ? » dit Charles doucement.
Elle ouvre un œil et se redresse pour s’extraire de son sommeil.
– « Vraiment désolé de vous réveiller. On s’est croisé la nuit dernière quand vous avez dû quitter la gare. Pardon, je vous ai interpellée assez excité. J’avais un peu trop bu. Je m’appelle Charles, et voici ma femme Lucile. »
– « Enchantée, je m’appelle Francine », dit la jeune femme étonnée et toujours dans un demi sommeil.
Les deux visiteurs prennent place sur les fauteuils du carré, en face de Francine.
– « Lucile et moi, on se demandait :pourquoi vous dormez là ? Vous n’avez pas de logement ? »
– « Non, je n’en ai pas », répond Francine, se tournant un peu vers le mur, espérant que ce mouvement interrompe la rencontre et lui permette de reprendre son sommeil. Mais Charles est loin de lâcher l’affaire.
– « Vous venez de quel pays ? »
– « Du Cameroun. Je suis venue demander l’asile, je suis en France depuis 6 mois. »
Charles est content. Il voit déjà ses neurones en train de trouver des solutions à ses problèmes. Il lui présente ses trouvailles de la fin d’après-midi sur le net, sur les conditions et possibilités de l’asile en France. Une fois l’exposé terminé, il attend un sourire, un merci, une réaction. Mais rien ne vient. Francine le regarde cette fois fixement et lui dit d’une voix sans timbre.
– « Je passe mes journées à faire le tour des associations et mes soirées à appeler le 115. Et il n’y a que des réponses négatives. Il n’y a pas de place. Merci d’être venus me voir, mais la gare ferme dans trois heures et j’aimerais dormir ».
Charles interloqué, salue Francine de la main, et rejoint Lucile qui, se vivant comme une intruse, avait déjà éprouvé le besoin de se lever pour se mettre en retrait. Ils rentrent tous les deux chez eux, sombres, sans oser se regarder et sans se dire un mot. Une fois la chambre retrouvée, Charles se met dans son lit, vide de désir. Il ne sait pas trop dire s’il est triste ou vexé. En tout cas il n’est pas bien. Il est assez surpris d’ailleurs d’être autant touché. Il ne sait pas l’expliquer. Il dort mal. Il fait des cauchemars de femmes noires énormes qui rient, qui se moquent de lui, le bousculent, l’écrasent, l’étouffent.
Le lendemain matin, après la cérémonie du petit déjeuner, il emmène ses filles à l’école. Il les embrasse et les serre contre lui plus fort qu’à son habitude. Léa et Brune le regardent avec de grands yeux qui interrogent. Elles comprennent qu’il y a un truc qui ne tourne pas rond chez leur papa. Un petit coucou de la main plus tard, Charles conduit machinalement sa voiture jusqu’à son travail. Il se gare, sort du véhicule, et appelle son copain Louis.
– « Ça va Louis ?… La femme, les enfants ?… Ok, cool… Tu as cinq minutes ?… Merci, je fais vite. En fait, en rentrant de chez toi avant-hier, Lucile et moi on a rencontré une jeune Africaine, Francine, qui se faisait virer de la salle d’attente de la Part-Dieu. Figure-toi que cette nana a fait une demande d’asile une fois arrivée en France il y a 6 mois, et qu’elle ne trouve aucune place pour se loger, c’est dingue, non ?… Ah oui ? Tu sais que ça existe ?… Des centaines sur Lyon ??… Des enfants à la rue ?… Arrête ton cirque. Sérieusement, on est en France, on n’est ni au Cameroun, ni à Calcutta ! On reste riches, l’État est riche. L’État providence de ton pote Mitterrand, le RMI, le RSA, la CMU… C’est la France tout ça, non ? (Le ton monte. Charles s’énerve…) Comment je suis dans mon monde ? … Comment on n’est pas le pays des droits de l’homme… Tu fais chier Louis ! C’est toi qui est dans ton monde. À force de voir que des pauvres, tu penses que tout le pays est pauvre. Tu es toujours trop négatif… Ok, mais alors on fait quoi pour Francine ? Quoi rien ?!? Y a rien à faire !?! J’ai qu’à la prendre chez moi ?!?!?. (Charles s’étrangle. Il crie presque). Tu crois que j’ai que ça à foutre de loger une Africaine de 120 kg dans mon salon pendant 06 mois !! Tu fais vraiment chier Louis. Je me retrouve avec cette gosse sur les bras, et toi, tu te fous de ma gueule ?!… Comment je me prends pour Zoro ?? Merde ! Allez Salut. Elle est belle la gauche ! ».
Louis lance cette dernière estocade dans une phrase rageuse dans laquelle il mélange dans un grand effort, une touche de rire à son amertume, pour ne pas clore trop mal la conversation avec son pote Louis, auquel il tient beaucoup.
Il reste là, silencieux. Il est écœuré. Il sent son café du matin faire des tours et des tours dans son estomac, entraînant les fragments de ses tartines de beurre et de miel, dans une vitesse qui pourrait bien les expulser de leur orbite. Il s’assied sur le trottoir, respire calmement, met son visage dans ses mains. Il a envie de pleurer. Il ne comprend pas. Dans les dix dernières années, il a pleuré deux fois, le jour de la naissance de ses deux filles. Passent dans sa tête des discours de famille, des homélies à la messe quand il était enfant, la rhétorique des politiques pour lesquels il a voté. Aimez-vous les uns les autres ; la France pays des droits de l’Homme ; la croissance par la libéralisation du marché. Tout cela se mélange et lui donne un léger vertige. Il ferme les yeux et veut vite se reprendre. Il se force à ramener dans sa tête des images de ce qui fait son bonheur, la silhouette de Lucile qui marche devant lui, les petites bouilles de ses puces qui se pendent à son cou quand il rentre le soir, les discussions avec ses deux aînés, nés d’une précédente union, la sensation du vent sur son visage quand il se promène en bord de mer, sur le port de Saint-Raphael, en été… Il se calme ainsi, un peu.
Il rejoint son bureau. Il est blafard. À ses collaborateurs qui lui demandent s’il est malade, il répond que oui, qu’il est en dépression du fait de la mort de l’État providence. Il ne récoltera comme seul soutien que des rires étouffées et des regards ahuris. Mais Charles sent qu’il ne va pas bien, vraiment pas bien. C’est de ne pas savoir pourquoi qui le panique en fait. Il a la très étrange impression qu’un fluide s’insinue dans son corps, et semble lyser et grignoter les joints qui font sa solidité. Que lui a donc fait cette Africaine ? Il aurait dû garder le flyer du grand Mamadou désenvouteur qu’il avait retrouvé sur son pare-brise, la semaine dernière. Il s’amuse avec cette idée. Il regarde sur le pas de la porte, la salle d’attente de son étude. Il s’oblige à rentrer dans son bureau. Il allume son ordinateur. Ouf, quarante mails sont en attente et vont l’obliger à changer de pensées. La journée avance. La lyse, elle, progresse. Malgré les mails, Charles va de plus en plus mal. Un client entre dans son bureau et d’adresse à lui sur un ton méprisant, pour lui dire que l’orientation de son insert de cheminée ne lui convient pas. Charles le met dehors en lui hurlant d’aller passer quelques heures dans la salle d’attente de la Part-Dieu pour méditer sur sa connerie. Il envoie bouler son assistante qui souhaite avoir enfin une réponse pour ses congés, en lui disant qu’elle ferait mieux de savourer son travail plutôt que de penser à rien foutre. Il lance un « toi aussi tu me fais chier » à son collègue Éric qui, inquiet de perdre d’autres clients ou d’autres collaborateurs, lui suggère de rentrer chez lui se reposer. Charles saisit l’occasion. Il est 16 heures. Il rassemble ses affaires et rentre à pied jusqu’à l’école de ses enfants, qu’il récupère ainsi plus tôt. Les petites sont ravies et Charles soulagé, juste le temps de cet instant.
La fin d’après-midi passe, le début de soirée aussi. Charles ne mange rien au repas. Il est toujours pâle. Il cherche à éviter les regards de Lucile et de ses deux puces. Il ne veut pas les inquiéter. Sa femme ce soir-là, couche seule les filles et lit à chacune une histoire. Elle rejoint son homme dans la cuisine. Charles est assis devant la table. Elle s’assied à côté de lui. Elle pose sa main sur sa nuque en sirotant une tisane.
– « Ça va ? » lui demande-t-elle ?
– « Non, pas bien… J’ai appelé Louis ce matin au sujet de Francine. Il s’est foutu de moi, dit qu’il y a plein de gens comme elle à Lyon. Il dit que je ne connais pas la réalité du monde d’aujourd’hui, que l’État providence est mort au profit d’un État libéral. Il dit que si je veux faire un truc, on n’a qu’à la loger dans le salon… J’essaie de me faire à cette idée, mais je n’y arrive pas. On n’a pas de chambre pour elle. Et quand les amis passent, ce sera encore pire… Et les puces… On ne la connaît pas Francine… Si ça se trouve elle est effectivement folle… »
– « Mais Charles, Louis plaisantait. Personne ne te demande de loger cette femme. On ne peut pas tout maîtriser. Je crois que Louis a raison, le monde est ainsi, et on vit dans un milieu très protégé, sans contact avec cette réalité-là. Tu le sais bien un peu non ? »
– « Non, je ne suis pas sûr de le savoir. La France est riche malgré tout. Il y a plein d’associations humanitaires, d’argent pour la coopération. On a une culture chrétienne. On a notre devise : liberté, égalité, fraternité… »
Charles s’interrompt. Il sent là le vide de ses propos. Il sent fondre ses joints toujours davantage. Il ne s’est jamais perçu dans cet état. Il voit venir un effondrement. Il n’arrive pas à arrêter le processus.
– « Je crois que Francine m’a jeté un sort. Je sens un fluide, une sorte de gel qui se diffuse doucement en moi et qui fait fondre chacun de mes joints. J’ai l’impression que je vais perdre des morceaux, me disloquer ».
Lucile, les yeux écarquillés, laisse échapper un drôle de son, comme un éclat de rire ravalé par la bouche à peine sorti par le nez.
– « Mais qu’est-ce que tu racontes. Tu vas finir par me faire flipper. Allez, on va se trouver un bon film, on se met sur le canap, et tu te changes les idées. Ou je te fais un long massage ! »
– « Non, je sais ce que je vais faire. Je vais aller la voir, et lui proposer de dormir dans la salle d’attente de l’étude. Elle sera au propre, au chaud, tranquille le temps de la nuit, et il y a les toilettes et le lavabo, où elle pourra prendre soin d’elle. Il faut que j’y aille et mettre fin ainsi à son sortilège » lance-t-il dans l’espoir de faire rire Lucile autant que de se rassurer. « Attends-moi, je fais vite et après on voit le film ».
– « Non, je vais avec toi. Je vais chercher la voisine. Si tu crois que je vais te laisser seul dans le noir avec cette bombe qui a des seins qui rivalisent avec mes fesses, tu rêves ! »
Et les voilà qui prennent à nouveau la route de la gare. Charles ne dit pas un mot et serre la main de Francine, s’y accroche en fait. Plus ils avancent et plus il a peur. Le fluide se répand. Il le sent. Ils trouvent Francine devant le parvis de la Part-Dieu, en train d’écouter de la musique. Elle les voit et cette fois elle est bien réveillée. Elle leur sourit. Elle a l’air assez amusée de ces visites impromptues qui se répètent. Elle leur dit bonjour, mais remarque très vite la tête effectivement désunie de Charles et le visage inquiet de Lucile, un peu en retrait, comme à son habitude. Le silence se fait. Charles sait qu’il doit parler mais il sent que le fluide est très avancé dans son travail. Peut-être même que ce solvant-là a terminé son œuvre. Il sent que tout ce qu’il est, peut maintenant se disloquer. Déjà, une ou deux choses qui le constituent se détachent, sorte de petits cubes oranges doucement luminescents. Ces petites choses qui le font, paraissent se séparer, le quitter, comme s’il était un personnage en jeu de construction dont certains éléments se désolidarisent, flottant dans l’air juste devant lui, tournant doucement autour, suffisamment vite pour rester à petite distance et suffisamment lentement pour rester dans la gravité newtonienne de Charles. Dans cette déréalisation qui commence, Charles en un effort remarquable, parvient à rassembler ses idées.
– « Euh, voilà. Je… je n’arrive pas à accepter l’idée que vous dormiez à la rue. Je n’y arrive pas, je n’y peux rien… Je… je ne sais pas pourquoi. Je n’y peux rien. Peut-être que vous m’avez jeté un sort ? Peut-être que Louis a raison, que l’État providence n’existe pas… Je… »
Francine est assez interloquée, touchée sûrement aussi de cette scène improbable. Elle sourit et lui dit :
– « Allez ne vous en faites pas. Je ne vais pas mal vous savez. Je m’organise. Et puis je ne suis pas une sorcière. Je ne sais pas jeter des sorts. »
Charles se disloque de plus en plus. Il sent à chaque seconde que davantage de choses se séparent de sa structure. Il sent qu’elles commencent à former une sorte de halo fait de l’ensemble des petits cubes orangés qui vont autour de lui, comme un essaim tournoyant qui ébauche l’aura colorée d’un coucher de soleil. Il ne peut plus, ni regarder sa femme dont il sent heureusement la présence derrière lui, ni regarder Francine juste là, devant lui. Il sent que l’effondrement est tout proche. Il ne sait plus vraiment s’il est encore là. Pourtant, dans un admirable courage, il arrive, à reprendre la parole tout en commençant à pleurer :
– « En fait, je veux prendre soin de vous… Enfin, j’ai besoin de prendre soin de vous… Je veux vous proposer de dormir dans la salle d’attente de mon travail. Vous serez bien. Au chaud. Vous aurez une salle de bain à disposition. À la maison, c’est compliqué. Il y a toujours du passage. Je n’arrive pas à accepter l’idée que vous viviez chez nous. Je n’y arrive pas… J’ai trop honte. Pardon… J’en suis tellement désolé… »
Francine pose sa main sur l’épaule de Charles pour le secouer doucement.
– « Hey !, votre proposition me touche. Mais il faut ne pas vous mettre dans cet état. Allez, Ho ho, reprenez-vous. Moi, je vais bien. C’est mieux ici pour moi que là d’où je viens. »
Ça y est. Charles est disloqué en totalité. Il n’est plus qu’un ensemble de petites choses oranges et désunies qui flottent autour de ce qu’il est, en tournant maintenant assez vite autour de lui et de sa gravité. Il forme un nuage, ou plutôt une sorte de corps éthérique, qui dégage une douce lumière et presque de la chaleur. C’est évidemment une situation complétement inédite pour lui, inconnue et fort désagréable. Il ne peut plus parler. Il pense qu’il va disparaître. Mais il veut en même temps ne rien perdre de l’expérience en cours, qui doucement prend pour lui un intérêt en elle-même. La fixette sur la situation de Francine lâche progressivement son étreinte, et il peut avec curiosité s’intéresser aux petites choses orangés et luminescentes qui lui tournent autour, qui sont siennes en fait. Il a l’impression de découvrir des ressources qui sont tout autant de lui qu’elles lui sont inconnues, un soi inconnu et plus profond, peut-être à l’image du monde des fées, des lutins et des génies qu’évoquait Foucault. « Corps incompréhensible, corps pénétrable et opaque, corps ouvert et fermé, corps utopique », corps visible qui se révèle là invisible.
Il ne peut plus ouvrir les yeux. Il ne peut plus que marmonner en boucle entre ses sanglots « et merde, il est où l’État providence », pour supporter l’expérience en cours. Il devient chose, « architecture fantastique et ruinée ». Charles comprend que son corps n’est pas un ici irrémédiable mais qu’il est peut-être simplement ailleurs qu’il ne le pensait. Son corps là se lie à bien d’autres ailleurs du monde. Il entend les paroles de Foucault qu’il écoutait d’une oreille l’autre jour quand Lucile, elle, écoutait captivée. « Le corps n’a pas de lieu mais c’est de lui que sortent et que rayonnent tous les lieux possibles, réels ou utopiques ». Il perçoit qu’il a un corps, « que ce corps à une forme, que cette forme a un contour, que dans ce contour il y a une épaisseur, un poids, bref que le corps occupe un lieu », mais le lieu là est complétement inédit.
Francine le voit chanceler et a peur qu’il tombe. Elle le saisit de ses deux mains. Lui, ayant perdu le contact avec bon nombre de ses cases, croit comprendre qu’elle veut le prendre dans ses bras. Il saisit ce qu’il perçoit comme une opportunité, et se blottit contre elle, posant son visage sur le haut de sa poitrine. Le contact avec ce corps-là semble le soulager. Sa gravité se modifie de fait et certains des petits éléments oranges qui tournent autour de lui reprennent place en lui. Il éprouve le besoin d’accentuer le contact avec Francine, avec Lucile aussi pour que les choses orangées autour de lui le retrouvent. Il essaye d’enfouir davantage son visage entre les deux seins énormes de Francine. Il voit la scène en film muet de Tout sur ma mère d’Almodovar où un homme au corps rétréci, finit par se glisser tout entier dans le sexe de son amante. Mais lui, là, ne cherche ni la fusion, ni l’anéantissement. Il cherche au contraire à se réunir. Il sent qu’il parvient à se caler ainsi, au plus loin qu’il peut aller. Il sent l’odeur poivrée de la peau noire de Francine et perçoit, dans cette caverne-là un vrai réconfort. Il aimerait que Lucile qu’il sent derrière lui, se colle contre lui pour enclore complètement son abris et y trouver, au contact de la peau des deux femmes, une solution de reconstruction. Il poursuit en boucle entre de grands sanglots « il est où l’État providence »…
Francine se retrouve là, avec Charles blotti contre elle, le nez plongé dans son décolleté, à la vue de tous les passants, qui eux n’osent pas trop regarder la scène même s’ils en ont très envie. Assez gênée, Francine cherche une solution de sortie dans le regard de Lucile. Lucile, elle, est franchement chamboulée. Elle ne sait pas si elle va pouffer de rire, ou éclater en sanglots. Finalement, elle sourit en laissant couler les larmes sur ses joues. En réponse au regard de Francine qui l’interroge, elle hausse les épaules, mimant qu’elle ne sait pas bien ce qu’il faut faire. Francine sourit, empêchant fermement de sortir le fou-rire qui la guète, et l’envie d’extraite de force Charles de son refuge. Elle cherche très vite un truc à dire :
– « Si l’État providence n’existe pas, nous avons là au moins le citoyen-providence. C’est bon. »
Charles lui, sent l’orage passer. Et les petites choses oranges une à une reprennent place. Ses larmes se tarissent. Il tait sa boucle sur l’État providence. Il prend lentement conscience de ce qui l’entoure et qu’il est là devant la gare de la Part-Dieu, le visage enfoui entre les deux seins d’une jeune femme de 23 ans qu’il ne connait à peine, sous le regard de Lucile, la femme qu’il aime, et des passants qui passent.
Lucile, elle, félicite et remercie Francine du geste de son pouce dréssé. Ses larmes coulent toujours. Elle a là une image bien nouvelle de son homme. Elle se demande comment sera la vie avec lui maintenant. Elle est amoureuse toujours. Elle se rappelle la phrase de Foucault qu’elle avait griffonnée sur un papier en l’écoutant pour ne pas l’oublier :
« Faire l’amour, c’est sentir son corps se refermer sur soi, c’est enfin exister hors de toute utopie, avec toute sa densité entre les mains de l’autre. Sous les doigts de l’autre qui vous parcourt, toutes les parts invisibles de votre corps se mettent à exister, contre les lèvres de l’autre, les vôtres deviennent sensibles ; devant ses yeux mi-clos, votre visage acquiert une certitude. Il y a un regard enfin pour voir vos paupières fermées. L’amour lui aussi comme le miroir et comme la mort, il apaise l’utopie de votre corps, il la fait taire, il la calme, il l’enferme comme dans une boîte, il la clôt et il la scelle. C’est pourquoi il est si proche parent de l’illusion du miroir et de la menace de la mort. Et si, malgré ces deux figures périlleuses qui l’entourent, on aime tant faire l’amour, c’est parce que dans l’amour, le corps est ici ».
Certes Charles et Francine n’ont pas fait l’amour au sens où Foucault l’entend là, mais pour autant, au contact de cette rencontre depuis 3 jours, et de la peau poivrée de la poitrine de Francine en cet instant, Charles aura bien découvert des parts invisibles de son être. Francine lui aura à la fois révélé que son corps, que ce qu’il est en entier, existe aussi autre part que ce qu’il pouvait appréhender auparavant. Il est là ainsi. Il est ici autrement. Elle lui a permis dans le même temps, de ne pas se disloquer et disparaître, de très vite retrouver un contenant, de rester assemblé et poursuivre. Rencontre autant improbable que providentielle.
Lucile regarde Charles et Francine, toujours là imbriqués, et se demande en fait, lequel des deux est le citoyen-providence.
FOUCAULT Michel (2009, [1966]). Le corps utopique, les hétérotopies. Paris : Lignes, 61p.
Corps utopiques est une conférences radiophonique prononcée par Michel Foucault, le 7 décembre 1966 sur France-Culture.